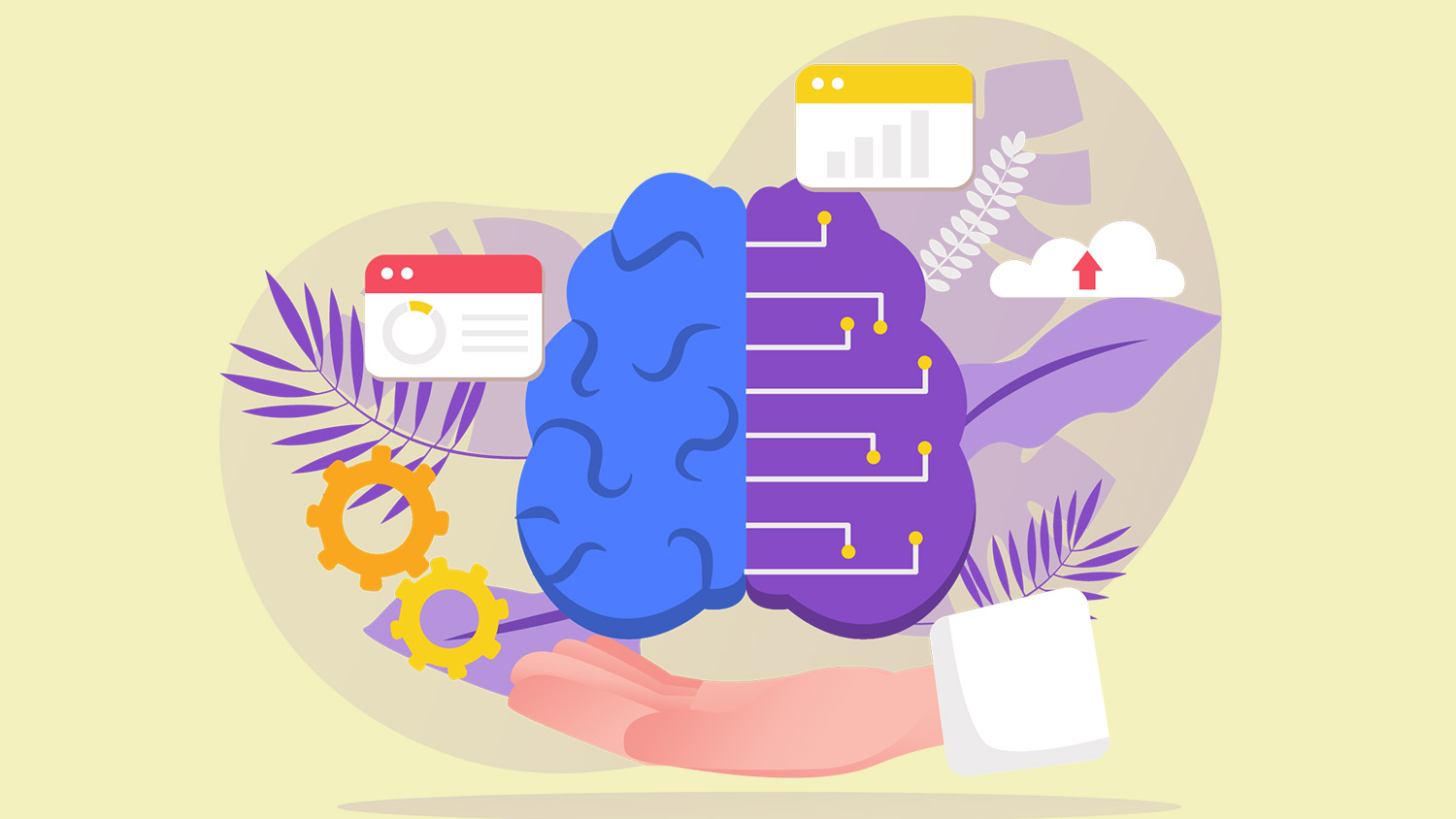
Comment l'IA influence notre mémoire – L'externalisation cognitive en action
Nous vivons une révolution silencieuse : celle de la mémoire humaine. Avec l'essor des intelligences artificielles, nos souvenirs migrent vers des serveurs, nos connaissances se fragmentent, et notre rapport au savoir se transforme radicalement. Que devient notre identité cognitive quand nous n'avons plus besoin de nous souvenir ? Oui c'est pour introduire la question de l'identité et de la mémoire, je savais que vous suiviez.
Introduction : La mémoire à l'heure de l'IA
Dans le métro parisien, Sarah vérifie l'itinéraire sur son smartphone, demande à son assistant vocal de lui rappeler son rendez-vous, puis utilise ChatGPT pour préparer une présentation. En quelques minutes, elle a externalisé trois fonctions mentales : navigation spatiale, mémoire prospective, et rédaction structurée. Cette scène banale illustre une transformation profonde : la mémoire humaine n'est plus ce qu'elle était.
Longtemps considérée comme une faculté interne et individuelle, la mémoire traverse aujourd'hui une mutation fondamentale. Avec l'omniprésence des assistants numériques, des moteurs de recherche instantanés et des intelligences artificielles capables de générer, résumer ou rappeler l'information, une question essentielle émerge : que devient notre mémoire quand nous n'avons plus besoin de nous souvenir ? Oui bon c'est presque "putaclic" mais comme je ne demande pas qu'on clique...
Cette transformation s'inscrit dans un phénomène que les sciences cognitives nomment externalisation cognitive (cognitive offloading) : le transfert volontaire de tâches mentales vers des supports extérieurs. Autrefois limité au papier et au crayon, ce processus s'étend aujourd'hui à des systèmes d'intelligence artificielle capables d'apprendre, d'anticiper nos besoins, et même de nous connaître mieux que nous ne nous connaissons. C'est réel, vérifiable et reproductible, donc scientifiquement démontré on vous dit !
Cette évolution puise ses racines théoriques dans la cognition étendue, concept développé par Andy Clark et David Chalmers en 1998. Selon eux, l'esprit humain dépasse les limites biologiques du cerveau et intègre les outils technologiques dans ses processus mentaux. Dans cette perspective, un smartphone ou une IA ne constituent plus de simples instruments, mais des extensions fonctionnelles de notre esprit. Bref ils ont découvert pourquoi James Bond n'existe pas sans ses gadgets, extensions facultatives mais bien pratiques des capacités humaines.
Le parallèle avec l'évolution des objets du quotidien est frappant. Qui se souvient que le barbecue, initialement conçu comme une solution de cuisson rudimentaire pour le camping, est devenu l'accessoire indispensable des réceptions ? De la même manière, les outils d'IA, nés pour résoudre des problèmes spécifiques, pourraient redéfinir notre rapport fondamental à la connaissance et à la mémoire.
Cette métamorphose soulève autant d'espoirs que d'inquiétudes. D'un côté : gain de temps, allègement de la charge mentale, accès démocratisé au savoir. De l'autre : dépendance technologique, atrophie cognitive, perte d'autonomie intellectuelle. Entre ces deux extrêmes, la mémoire se réinvente comme fonction stratégique en interaction avec un écosystème technologique en perpétuelle évolution.
Cet article propose d'explorer ces mutations à travers une approche multidisciplinaire, mobilisant les dernières recherches en psychologie cognitive, neurosciences, et philosophie de l'esprit. Nous verrons comment l'externalisation cognitive redéfinit la mémoire humaine : menace pour nos capacités cognitives, ou opportunité de construire une mémoire hybride, augmentée et maîtrisée ? Oui je sais c'est lourd ces questions en fin de partie mais on me dit que c'est pour maintenir l'attention du lecteur...
Le délestage cognitif : mécanismes et fondements théoriques
Définition et mécanismes
Le délestage cognitif désigne l'ensemble des stratégies par lesquelles nous transférons volontairement des tâches mentales vers des supports externes. Cette pratique, observée depuis l'invention de l'écriture, connaît aujourd'hui une accélération sans précédent avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas Alexandre Dumas qui nous contredira sur cette externalisation.
Contrairement à une idée reçue, le délestage cognitif ne résulte pas d'une paresse intellectuelle, mais constitue une adaptation évolutive optimale. En externalisant certaines fonctions, nous libérons des ressources mentales pour des tâches plus complexes ou créatives. Cette stratégie d'économie cognitive trouve ses fondements dans la théorie de la charge mentale développée par John Sweller : notre système cognitif, limité en capacité, optimise naturellement l'allocation de ses ressources.
Les recherches expérimentales d'Evan Risko et Sam Gilbert (2016) ont démontré que les individus ayant accès à un support numérique choisissent spontanément de déléguer des tâches cognitives, même lorsqu'ils possèdent les compétences pour les réaliser mentalement. Cette préférence pour l'externalisation ne traduit pas une incapacité, mais une stratégie d'optimisation : pourquoi mobiliser sa mémoire de travail pour retenir un numéro de téléphone quand celui-ci peut être stocké instantanément dans un carnet de contacts ? L'ancienne appellation de ce principe était : "le moindre effort."
La cognition étendue : repenser les frontières de l'esprit
Cette pratique s'inscrit dans une conception révolutionnaire de l'intelligence humaine : la cognition étendue. Formulée par Andy Clark et David Chalmers dans leur article fondateur The Extended Mind (1998), cette théorie propose que nos processus mentaux ne se limitent pas à notre cerveau, mais s'étendent à notre environnement immédiat dès lors qu'il est intégré de façon fluide dans nos routines cognitives.
Pour qu'un outil externe devienne partie intégrante de notre système cognitif, il doit respecter trois critères :
Accessibilité constante : l'information doit être disponible quand nous en avons besoin
Récupération automatique : l'accès ne doit pas nécessiter d'effort conscient
Approbation automatique : nous devons faire confiance à l'information récupérée.
Selon cette perspective, écrire un numéro dans son agenda ou demander à ChatGPT de résumer un texte ne constitue pas un renoncement à penser, mais une façon de penser autrement, à travers un dispositif externe qui devient une partie fonctionnelle de notre esprit.
Cependant, cette vision optimiste mérite une nuance. L'exemple de nos difficultés croissantes à choisir un film sur les plateformes de streaming illustre une limite : l'abondance de choix, même assistée par des algorithmes, peut paradoxalement complexifier la décision. Combien abandonnent leur recherche, préférant "faire autre chose" ? Cette réalité suggère que le "penser autrement" ne correspond pas toujours à la nature humaine, qui recherche naturellement le moindre effort (puisqu'on vous le dit ! ).
Confirmation neuroscientifique
Les neurosciences apportent un éclairage fascinant sur ces mécanismes. Des études récentes en imagerie cérébrale suggèrent des modifications dans l'activité de certaines régions du cerveau, notamment le cortex préfrontal, lorsque nous externalisons des tâches mentales via des outils numériques.
Cette modification neurologique confirme que l'outil ne se contente pas de nous aider : il pourrait transformer notre façon d'utiliser notre cerveau. Plus troublant encore, cette réorganisation pourrait devenir durable. Des recherches suggèrent que l'usage intensif d'outils numériques pourrait modifier les patterns d'activation neuronale, notamment dans les zones responsables de l'attention soutenue et de la mémoire de travail.
Cette plasticité cérébrale constitue à la fois une force et une vulnérabilité. Force, car elle témoigne de notre capacité d'adaptation exceptionnelle. Vulnérabilité, car elle implique que nos choix technologiques actuels pourraient façonner le cerveau de demain. Bref que notre activité nous forme. Oui je sais mes réparties sont souvent des moqueries mais c'est pour rappeler qu'enfoncer des portes ouvertes ce n'est pas toujours très difficile, par contre ne pas oublier de les fermer...
Typologie des mémoires et impacts différenciés de l'IA
La mémoire de travail : première victime de l'externalisation
Pour comprendre pleinement l'impact de l'intelligence artificielle sur notre cognition, il convient de distinguer les trois grands systèmes mnésiques identifiés par les sciences cognitives. Chacun interagit différemment avec les technologies numériques et subit des transformations spécifiques. J'insiste sur le faits que ce sont des théories, nous n'avons absolument pas découvert biologiquement ces mémoires. C'est une hypothèse, une idée argumentée.
La mémoire de travail représente notre capacité à maintenir temporairement des informations disponibles pour des opérations mentales immédiates. Limitée à environ 7 éléments selon George Miller (1956), plus récemment révisée à 4 par Nelson Cowan (2001), elle constitue le goulot d'étranglement de notre système cognitif. C'est précisément cette mémoire que nous délestons en priorité.
L'usage massif d'outils comme les rappels automatiques, les assistants vocaux, ou les listes générées par IA illustre à quel point nous externalisons les processus de maintien attentionnel. Cette pratique réduit effectivement la charge cognitive, mais elle diminue aussi l'entraînement de cette capacité fondamentale.
Comme le rappellent Klaus Oberauer et Stephan Lewandowsky (2011), la mémoire de travail est remarquablement plastique : elle se renforce par l'usage et décline par sous-utilisation. Les conséquences de cette atrophie dépassent le simple inconfort : la mémoire de travail sous-tend des fonctions cognitives supérieures comme le raisonnement, la compréhension, et la créativité.
Des recherches récentes suggèrent que les étudiants utilisant intensivement des outils numériques pourraient présenter des différences dans leurs stratégies de mémorisation et de résolution de problèmes. J'avoue que ces points sont ici parce que documentés mais je suis toujours très réservé quant à la quantification de concepts... tel le raisonnement, la compréhension, la créativité... mais vous avez le droit d'en faire ce que bon vous semble, vous êtes avertis.
La mémoire sémantique : de la rétention à la recherche
La mémoire sémantique regroupe nos connaissances générales sur le monde : faits, concepts, vocabulaire, règles. Traditionnellement, cette mémoire se construisait par accumulation et consolidation progressive. L'IA bouleverse cette logique en offrant un accès instantané à un réseau de savoirs virtuellement illimité.
Cette accessibilité transforme radicalement notre stratégie d'apprentissage. Nous n'apprenons plus pour retenir des informations mais pour savoir comment et où les chercher. Cette mutation correspond à ce que Betsy Sparrow et ses collègues ont nommé l'effet Google : nous retenons moins l'information elle-même que l'endroit où la trouver.
Cette évolution soulève une question fondamentale : peut-on comprendre sans retenir ? On avait la réponse pour la réciproque mais il faut toujours compliquer, c'est humain, enfin perroquet pour la réciproque. La compréhension profonde nécessite-t-elle une base de connaissances internalisées, ou peut-elle émerger de l'interaction dynamique avec des sources externes ? Bon dis comme ça on peut quand même supposer que oui, sinon on se demande comment on ferait pour résoudre un problème qu'on rencontre pour la première fois. Comme disait Confucius (attention ! Citation approximative) : "L'expérience, comme une lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire que le chemin déjà parcouru."
Les recherches en sciences de l'éducation suggèrent une réponse cependant nuancée. Si l'accès externe peut effectivement soutenir la compréhension dans certains domaines, il existe des seuils critiques en deçà desquels la compréhension s'effondre. Daniel Willingham, psychologue cognitif à l'Université de Virginie, démontre que la pensée critique nécessite un socle minimal de connaissances automatisées. Sans ce socle, l'individu reste tributaire de sources externes, limitant sa capacité d'analyse autonome. Bref c'est le perroquet qui l'emporte.
Plus profondément, cette transformation interroge notre rapport à l'existence elle-même. Notre être-au-monde repose largement sur nos connaissances mémorisées. Externaliser massivement ce savoir, c'est potentiellement nous placer en situation de dépendance existentielle vis-à-vis de nos outils. Aurons-nous encore les réflexes adaptatifs nécessaires pour naviguer dans un monde complexe si notre mémoire sémantique s'appauvrit ? Pourrait-on voir là une des raisons des déclins successifs et apparemment inévitables des civilisations ?
La mémoire épisodique : quand l'enregistrement remplace l'expérience
La mémoire épisodique – notre mémoire autobiographique des événements vécus – subit elle aussi des transformations profondes. L'enregistrement constant de notre quotidien (photos, vidéos, journaux numériques, géolocalisation) tend à remplacer la narration mentale et la consolidation naturelle du souvenir.
L'expérience de Joanna Stern, journaliste au Wall Street Journal, illustre ce phénomène de façon saisissante. Durant plusieurs mois, elle a testé des dispositifs d'enregistrement vocal portables capturant ses interactions. Résultat : elle constatait un affaiblissement de son besoin de reconstituer mentalement ses souvenirs.
Cette observation n'est pas anecdotique. La consolidation mémorielle repose sur un processus de reconstruction active, lors duquel le cerveau "rejoue" les événements, les relie à des expériences antérieures, et leur donne du sens. En externalisant ce processus, nous risquons de produire des traces mémorielles superficielles, riches en détails factuels mais pauvres en signification personnelle. Par signification personnelle, il faut surtout entendre la capacité de ces souvenirs personnels à influencer nos comportements.
Les neurosciences suggèrent que l'hippocampe, structure cérébrale cruciale pour la formation des souvenirs, pourrait montrer des patterns d'activation différents chez les individus qui s'appuient massivement sur l'enregistrement externe. Cette modification pourrait, à long terme, altérer notre capacité à former des souvenirs durables et significatifs.
Le paradoxe est saisissant : en voulant mieux préserver nos souvenirs grâce à la technologie, nous risquons de les vider de leur substance existentielle. Que devient l'identité narrative, cette capacité à se raconter sa propre histoire, si celle-ci repose sur des archives externes plutôt que sur une mémoire vécue et intégrée ? Demandé autrement : vous les avez regardé récemment vos 5700 photos stockées dans votre cloud ?
L'effet Google et l'amnésie numérique : mécanismes et conséquences
Genèse et validation scientifique
L'effet Google, identifié pour la première fois par Betsy Sparrow, Jenny Liu et Daniel Wegner en 2011, constitue l'une des découvertes les plus significatives de la psychologie cognitive moderne. Publié dans Science, leur travail démontre que lorsqu'une information est facilement accessible en ligne, les individus la mémorisent moins bien, mais retiennent mieux l'emplacement où elle peut être retrouvée. Quand je pense que c'est ça une découverte des plus significatives en psychologie cognitive... Encore un effort et on va enfin réconcilier les lacanien et les cognitivistes autour des noeuds... au mouchoir pour se souvenir. Je sais je taquine encore.
Cette découverte révolutionne notre compréhension de la mémoire humaine. Le cerveau, système d'optimisation énergétique par excellence, réalloue automatiquement ses ressources : plutôt que de stocker l'information elle-même, il privilégie une mémoire de localisation, plus économique et apparemment plus fonctionnelle.
Les expériences de Sparrow et ses collègues révèlent trois phénomènes convergents :
Amnésie induite : les participants retiennent moins bien les informations qu'ils savent pouvoir retrouver
Mémoire compensatoire : ils se souviennent mieux des moyens d'accès (dossiers, mots-clés, sources)
Adaptation anticipatoire : cette stratégie s'active même avant la consultation effective, dès que l'accessibilité est perçue
Pourrait-on en déduire que les capacités d'adaptation de l'humain sont sa seule principale ressource pour assurer sa survie?
Amplification à l'ère de l'IA
Si l'effet Google était déjà observable avec les moteurs de recherche classiques, l'avènement de l'IA conversationnelle l'amplifie considérablement. ChatGPT, Claude, et leurs homologues ne se contentent plus de localiser l'information : ils la synthétisent, l'adaptent, et la personnalisent en temps réel. Cette facilité d'accès inédite accélère le processus d'externalisation cognitive.
Des études récentes en offloading cognitif (Journal of Memory and Language, 2021) montrent un compromis entre performance immédiate et mémoire à long terme : l'assistance améliore les résultats immédiats mais peut réduire la rétention à long terme lorsque l'assistance n'est plus disponible.
L'effet s'étend au-delà de la simple mémorisation factuelle. Les participants montrent également une diminution de leur tolérance à l'incertitudeet une tendance accrue à chercher des confirmations externes plutôt qu'à développer leur réflexion autonome.
Conséquences développementales
L'amnésie numérique affecte particulièrement les jeunes générations, dont le développement cognitif coïncide avec l'omniprésence des outils numériques. Une étude de Kaspersky (2015, mise à jour en 2023) révèle que 91% des consommateurs admettent leur dépendance aux appareils comme extension de leur cerveau. Je doute que ce soit réellement le cas mais c'est une source documentée, donc j'en fais état.
Cette anxiété informationnelle, si confirmée, traduit plus qu'une simple dépendance : elle révèle un changement structurel dans la gestion de l'incertitude cognitive. Là où les générations précédentes développaient une tolérance à l'ignorance temporaire, les "digital natives" semblent avoir externalisé cette fonction, créant une vulnérabilité psychologique inédite.
Les implications éducatives sont majeures. Si l'école continue d'évaluer la mémorisation factuelle dans un monde où celle-ci devient obsolète, elle risque de passer à côté des véritables enjeux cognitifs : apprendre à questionner, synthétiser, créer des liens, développer son esprit critique.
Redéfinition du savoir
L'effet Google interroge notre définition même du savoir. Peut-on encore parler de "connaissance" si celle-ci n'existe que sous forme consultable ? Cette question dépasse la simple ergonomie cognitive : elle touche aux fondements de l'éducation, de la culture, et même de l'identité intellectuelle.
Certains philosophes, comme Bernard Stiegler, y voient une désappropriation de la connaissance : en externalisant massivement nos savoirs, nous risquons de perdre la capacité à penser de façon autonome. D'autres, comme Andy Clark, considèrent au contraire que cette évolution élargit notre intelligence au-delà de ses limites biologiques. Ce débat est ancestral car les livres n'étaient pas prisé par Aristote lui-même pour des raisons similaires. Ça ne nous rajeunit pas, selon la formule populaire.
Cette tension conceptuelle se retrouve dans nos pratiques quotidiennes. Combien d'entre nous éprouvent une forme de malaise en consultant systématiquement leur smartphone pour vérifier une information qu'ils "devraient" connaître ? Cette gêne traduit peut-être la perception intuitive d'une perte, même si celle-ci s'accompagne de gains fonctionnels indéniables. Idem pour les traductions.
Études de cas : atrophie cognitive par délégation
La disparition de la mémoire numérique
L'un des exemples les plus frappants d'atrophie cognitive concerne notre rapport aux numéros de téléphone. Cette transformation, apparemment anodine, révèle des mécanismes profonds de restructuration mentale.
Avant l'ère des smartphones, mémoriser les numéros de téléphone constituait un automatisme social. Cette pratique sollicitait quotidiennement notre mémoire de travail et consolidait nos capacités de rétention séquentielle. Des études montrent qu'une majorité d'adultes connaissent désormais par cœur très peu de numéros, contre une moyenne de dix à quinze dans les années 1990.
Cette évolution dépasse la simple commodité : elle illustre comment l'externalisation peut désactiver des circuits cognitifs entiers. La mémorisation de séquences numériques sollicite l'aire de Broca, le cortex préfrontal, et l'hippocampe. En cessant de l'exercer, nous laissons ces réseaux neuronaux se réorganiser vers d'autres fonctions, ou s'atrophier.
Les conséquences dépassent le cadre numérique. Les tests neuropsychologiques suggèrent que les individus ayant cessé de mémoriser des numéros pourraient présenter des différences dans d'autres tâches séquentielles : retenir des instructions complexes, suivre des raisonnements multi-étapes, ou maintenir plusieurs idées en mémoire simultanément.
La navigation spatiale à l'ère du GPS
L'usage systématique du GPS illustre de façon spectaculaire les risques de l'externalisation cognitive. Les recherches massives de Sea Hero Quest (Topics in Cognitive Science, 2023), menées auprès de 4,3 millions de participants, ainsi que d'autres études sur la navigation spatiale, révèlent que les utilisateurs intensifs de GPS pourraient présenter des patterns d'activation différents de l'hippocampe, structure cérébrale cruciale pour la navigation et la mémoire spatiale.
Cette modification d'activité ne constitue pas un simple effet temporaire : des recherches suggèrent qu'elle pourrait devenir structurelle. Les individus qui utilisent exclusivement un GPS pendant plusieurs années pourraient développer des cartes mentales appauvries et perdre progressivement leur capacité à s'orienter de façon autonome.
L'enjeu dépasse la simple géographie. La navigation spatiale constitue un modèle pour d'autres formes de navigation cognitive : orientation dans les idées, dans les projets, dans les relations sociales. En externalisant notre boussole physique, risquons-nous d'altérer nos autres capacités d'orientation ?
Des études chez les chauffeurs de taxi londoniens, célèbres pour leur connaissance encyclopédique de la ville, montrent que leur hippocampe postérieur est significativement plus développé que la moyenne. Cette hypertrophie témoigne de la plasticité cérébrale : ce que nous sollicitons se renforce, ce que nous négligeons s'affaiblit.
Désapprentissage linguistique assisté
L'impact de l'IA sur les compétences linguistiques offre un cas d'étude particulièrement révélateur. Sam Schechner, journaliste au Wall Street Journal, a documenté sa propre expérience : après avoir utilisé ChatGPT pour rédiger ses emails en français pendant plusieurs mois, il a constaté une dégradation notable de sa fluidité linguistique.
Cette observation n'est pas isolée. Des recherches suggèrent que les étudiants utilisant massivement des outils de correction automatique et de génération de texte pourraient présenter une modification de leurs stratégies rédactionnelles. Paradoxalement, leurs textes produits avec assistance sont de meilleure qualité, mais leur capacité autonome pourrait diminuer.
Ce phénomène illustre un principe fondamental : les compétences cognitives suivent la loi de l'usage. Le langage, en particulier, nécessite une activation constante pour maintenir sa richesse et sa précision. En déléguant la production linguistique, nous risquons de voir notre expression s'appauvrir. Une autre expression bien connue a également précédé toute cette mise en forme théorique intellectuelle : "c'est en forgeant qu'on devient forgeron."
Plus troublant encore : cette atrophie peut devenir auto-entretenue. Plus la compétence décline, plus l'individu se tourne vers l'assistance automatique, accélérant le processus de désapprentissage. Ici c'est le fameux cercle vicieux.
Pour celles et ceux qui auront remarqué mon usage récurrent du conditionnel, il ne s'agit pas uniquement d'une précaution verbale, il traduit également mon doute quant aux implications réelles de ces constats dans les hypothèses de fonctionnement neurologique. Dis autrement : comme on n'a aucune idée du substrat physique (nature) de la pensée et de la mémoire, le conditionnel me semble très bien convenir pour rappeler que tout ce que nous en disons est hypothétique. C'est dit.
Bénéfices réels : vers une mémoire stratégique et augmentée
Optimisation cognitive et libération créative
L'externalisation cognitive, loin d'être uniquement problématique, offre des opportunités inédites d'optimisation mentale. En déléguant des tâches routinières à des systèmes intelligents, nous libérons des ressources cognitives pour des activités à plus haute valeur ajoutée : créativité, analyse critique, innovation, résolution de problèmes complexes.
Cette logique d'optimisation trouve sa justification dans la théorie de la charge cognitive développée par John Sweller. Notre système mental, limité en capacité, fonctionne de façon plus efficace lorsqu'il peut se concentrer sur l'essentiel. L'IA peut jouer le rôle de "gestionnaire cognitif", prenant en charge les aspects techniques pour laisser place à la réflexion stratégique.
Des études montrent que l'utilisation d'outils d'IA peut améliorer les performances dans certaines tâches. Des recherches récentes suggèrent que des étudiants utilisant l'IA générative obtiennent des améliorations de performance à court terme dans certaines tâches, même si des questions importantes demeurent sur la rétention à long terme et l'apprentissage autonome. Je ne vous cache pas que c'est comme cela que j'organise mon travail, avec en plus un premier jet IA à partir d'un plan détaillé augmenté par IA avec sources documentaires. Bref j'augmente ma productivité en déléguant les tâches automatiques à l'IA.
Démocratisation de l'expertise
L'IA comme extension cognitive présente un potentiel démocratique considérable. En rendant accessibles des capacités d'analyse et de synthèse sophistiquées, elle peut réduire les inégalités cognitives et permettre à des individus moins dotés en capital culturel d'accéder à des formes d'intelligence autrefois réservées à une élite.
Cette perspective transforme le débat sur l'externalisation cognitive. Plutôt que de déplorer une "démocratisation par le bas", nous pourrions assister à une élévation générale du niveau cognitif. L'IA pourrait jouer le rôle que l'écriture a joué dans l'histoire humaine : un amplificateur d'intelligence accessible à tous.
Des initiatives éducatives expérimentent déjà cette approche. Des écoles finlandaises utilisent des tuteurs IA personnalisés qui s'adaptent au rythme et au style d'apprentissage de chaque élève. Les résultats montrent une réduction significative des écarts de performance et une amélioration de l'engagement des étudiants en difficulté.
Il faut cependant nettement et directement préciser que l'argent est le facteur discriminant dans l'accès à ces possibilités augmentées. Le coût de l'IA (abonnements), tout comme le coût faramineux des revues prestigieuses et réputées très sérieuses comme la galaxie Nature, nous rappelle combien les ressources financières des individus et des familles sont déterminantes pour les enfants avant même de parler première évaluation Psy avec par exemple un Wisc ou une NEMI... tout aussi hors de prix ! Les bonnes intentions en santé mentale, éducation, accompagnement Psy de tous ordres, qu'on ne cesse de nous rappeler ad nauseam sur les réseaux sociaux pour trouver une clientèle permettant aux Psy (au sens très large) de vivre de leur profession, se heurtent immédiatement au mur du "steak sur la table." Je crois qu'une dose de réalité est toujours utile, en rappel. De même il ne faut pas penser aujourd'hui, en septembre 2025, que les assistants IA sont capables sans risque d'erreur de vous livrer une analyse sur l'Autre et la jouissance selon Lacan, ou bien une analyse historique détaillée et fiable sur les vrais motifs des chasses aux sorcières de la fin du moyen-âge jusqu'au XVIIIème siècle en Europe. Ce serait une erreur lourde de conséquence de penser ainsi. De même la propension incroyable des assistants Ia à l'invention pure et simple de sources inexistantes est problématique : c'est un euphémisme. Alors restons réaliste quant à ce que propose réellement l'IA de fiable pour le moment. Et SURTOUT vérifions toujours par nous-mêmes ses productions.
Construction d'une mémoire distribuée
L'IA permet de construire des systèmes de mémoire distribuée particulièrement sophistiqués. Des outils comme Obsidian, Roam Research, ou Notion AI offrent la possibilité de créer des "seconds cerveaux" numériques, capables non seulement de stocker l'information, mais de la structurer, de créer des liens sémantiques, et même de suggérer des connexions inattendues.
Cette approche dépasse la simple externalisation : elle crée une symbiose cognitive où l'humain et la machine collaborent de façon complémentaire. L'individu apporte l'intuition, la créativité, le sens critique ; l'IA fournit la capacité de traitement, la mémoire illimitée, la détection de patterns.
Ces systèmes hybrides peuvent développer une forme d'intelligence émergente, supérieure à la somme de leurs composants. Oui bon, en tout cas c'est l'idée générale... Des entrepreneurs utilisant ces outils rapportent une amélioration de leur capacité à identifier des opportunités, à anticiper des tendances, et à prendre des décisions stratégiques complexes. Donc j'en fais état, mais je reste dubitatif quant à la réelle efficacité de ces dispositifs tant il faut qu'ils correspondent à la personnalité de leur utilisateur. Je m'explique : demander à une personne "bordélique" de se structurer à l'aide de ces dispositifs me semble voué à l'échec car ça ne répond pas à la structure psychique de la personne. Mais je peux me tromper.
Métamémoire et conscience cognitive
L'IA peut également jouer un rôle crucial dans le développement de la métamémoire : cette capacité à connaître et réguler ses propres processus mnésiques. En offrant des retours sur nos habitudes cognitives, nos biais, nos lacunes, elle peut nous aider à devenir de meilleurs penseurs. Je dois vous indiquer que je ne crois pas du tout à cette hypothèse, comme pour la pyramide de Maslow, ça me semble déjà invalidé avant d'avoir terminé la rédaction de l'explication... Plus sérieusement, comment peut-on postuler une telle hypothèse alors que nous ne connaissons pas le substrat matériel de la mémoire ?
Des applications émergentes proposent déjà des fonctionnalités de "coaching cognitif" : analyse des patterns de recherche, identification des domaines de connaissance sous-exploités, suggestions d'approfondissement. Cette approche réflexive peut transformer l'IA d'un simple outil d'assistance en partenaire de développement intellectuel. Nintendo et son jeu du Docteur Kawashima étaient finalement des visionnaires. Plaisanterie à part, je pense que c'est une voie prometteuse de véritable assistance IA et non un remplacement par l'IA.
L'enjeu est de développer une conscience augmentée de nos propres fonctionnements mentaux. Plutôt que de subir passivement l'externalisation, nous pourrions apprendre à la piloter de façon stratégique, en gardant la maîtrise de nos choix cognitifs. J'ai gardé ce terme risible dans ce contexte de conscience augmentée car on commence à le trouver version tarte à la crème dans des articles pourtant annoncés sérieux. Ça n'est pas sans rappeler le fameux sketch de Coluche sur la pub avec la fameuse lessive qui lavait plus blanc que blanc.
Les risques invisibles : complaisance cognitive et désapprentissage
La complaisance cognitive : un danger silencieux
À mesure que l'IA devient plus performante et intuitive, elle induit un risque particulièrement insidieux : la complaisance cognitive. Ce phénomène, documenté depuis 2022 dans plusieurs études internationales, désigne la tendance croissante à faire confiance par défaut aux suggestions automatisées, sans exercer de vérification critique. Grave erreur que j'ai déjà mentionné !
Cette confiance excessive trouve ses racines dans plusieurs biais psychologiques convergents. D'abord, l'effet d'autorité : nous attribuons spontanément une expertise supérieure aux systèmes que nous percevons comme "intelligents". Ensuite, l'aversion à l'effort : la vérification demande un investissement cognitif que nous évitons naturellement. Enfin, l'illusion de compétence : utiliser un outil performant nous donne l'impression de maîtriser ses outputs.
Des recherches récentes en offloading cognitif (sorte de décharge mentale vers l'IA) suggèrent que l'utilisation intensive d'IA pourrait modifier nos stratégies de pensée critique, particulièrement dans l'évaluation d'arguments contradictoires et la détection d'erreurs factuelles.
Cette détérioration n'est pas uniforme : elle affecte surtout les fonctions de contrôle et de validation. Les individus restent capables de traiter l'information, mais perdent progressivement l'habitude de la questionner. Cette passivité critique peut avoir des conséquences préjudiciables dans des domaines sensibles : médecine, finance, ingénierie, éducation.
Désapprentissage et atrophie fonctionnelle
La complaisance cognitive s'accompagne d'un phénomène plus subtil mais tout aussi problématique : le désapprentissage passif. Lorsqu'une compétence cognitive est systématiquement externalisée, elle devient progressivement invisible, cessant de solliciter les circuits neuronaux habituels et induisant leur affaiblissement graduel.
Ce processus suit une logique neurobiologique implacable. Comme le rappelle Michel Desmurget, neuropsychologue reconnu, "le cerveau est un organe d'économie énergétique. Ce qu'il ne pratique pas, il le désinvestit." Cette loi de l'usage s'applique particulièrement aux fonctions cognitives complexes : raisonnement, mémorisation, attention soutenue. C'est vraiment dommage là encore qu'on n'ait pas la moindre trace du substrat physique pour soutenir ces assertions. Ça viendra mais pour l'instant nous sommes dans l'hypothèse.
Des recherches suggèrent que l'usage intensif d'assistants IA pourrait produire des modifications observables dans les patterns d'activation cérébrale. Les zones responsables de la planification autonome (cortex préfrontal dorsolatéral) et de la mémoire de travail (cortex pariétal) pourraient présenter une activité modifiée, même lors de tâches ne nécessitant pas d'assistance technologique.
Cette atrophie fonctionnelle ne se limite pas aux capacités cognitives élémentaires. Elle pourrait affecter aussi des compétences plus sophistiquées comme la tolérance à l'ambiguïté, la pensée divergente, ou la capacité à maintenir plusieurs perspectives simultanément. En simplifiant excessivement les processus décisionnels, l'IA peut réduire notre adaptabilité cognitive face à des situations inédites. Une autre approche assez similaire serait de soutenir qu'une uniformisation de réponses (donc une inadaptation croissante, c'est essentiel à saisir) va se généraliser du fait de l'IA et des corpus d'entrainement si l'on ne met pas en place des processus intermédiaires de validation-correction. C'est notre prochain paragraphe.
Standardisation cognitive et pensée homogène
Un autre risque majeur réside dans la standardisation cognitive induite par l'usage massif des mêmes outils d'IA. Lorsque des millions d'utilisateurs interrogent les mêmes modèles, reçoivent des réponses similaires, et adoptent des patterns de raisonnement convergents, nous assistons à une forme d'homogénéisation de la pensée.
Cette convergence s'observe déjà dans plusieurs domaines. Les textes produits avec assistance IA présentent des structures récurrentes, un vocabulaire standardisé, et des développements prévisibles. Plus inquiétant : les individus utilisant intensivement ces outils tendent à reproduire ces patterns même dans leurs productions autonomes. Le tiret cadratin se généralise même dans les messages brefs en remplacement de notre traditionnelle virgule de ponctuation ! Sois dit en passant, cela m'a permis de découvrir un usage différent de ces tirets en remplacement de mes parenthèses que j'utilisais jusque-là automatiquement pour toute précision ou aparté. L'honnêteté c'est aussi de reconnaître ce que m'apporte ce que je critique.
Cette influence de l'utilisation de l'IA s'étend au-delà de la forme (expression) vers le contenu même de la pensée. Les modèles d'IA, entraînés sur des corpus massifs mais nécessairement limités, véhiculent des biais systémiques : surreprésentation de certaines perspectives culturelles, sous-représentation de voix minoritaires, reproduction d'archétypes sociaux problématiques.
L'enjeu dépasse la diversité intellectuelle : il touche à la créativité collective de notre société. Si nos outils cognitifs convergent vers des solutions similaires, nous risquons de voir s'appauvrir notre capacité collective d'innovation et d'adaptation. La disparition de l'originalité est alors malheureusement à portée de nous.
Je ne peux m'empêcher ici une digression vers la créativité en psychothérapie. Ce que ne semble absolument pas avoir compris le cognitiviste orthodoxe c'est que l'application à la lettre d'une méthodologie à visée psychothérapeutiques ne peut qu'amener à la rencontre d'échecs car la créativité est l'unique moyen pour adapter (rendre efficace) la thérapie pour le patient. Autrement dit : nous sommes tous différents, par quel miracle une solution universelle appliquée de manière universellement identique pourrait réussir dans ce cas ? Autre domaine, même erreur fondamentale.
Vulnérabilité systémique et dépendance
L'externalisation massive de nos fonctions cognitives crée également une vulnérabilité systémique inédite. En devenant dépendants de systèmes technologiques complexes, nous nous exposons à des risques de disruption dont nous mesurons mal l'ampleur.
Cette dépendance opère à plusieurs niveaux. Au niveau individuel, la panne ou l'indisponibilité temporaire de nos outils peut provoquer une désorientation cognitive disproportionnée. Des études montrent que les utilisateurs intensifs d'assistants numériques présentent des niveaux d'anxiété significativement plus élevés lorsqu'ils en sont privés, même temporairement.
Au niveau collectif, cette dépendance soulève des questions de sécurité cognitive. Que se passerait-il si les principaux systèmes d'IA devenaient indisponibles ? Ou s'ils étaient compromis ? Notre société a-t-elle maintenu suffisamment de capacités cognitives autonomes pour fonctionner en mode dégradé ?
Cette vulnérabilité s'étend aux dimensions géopolitiques. La concentration de l'expertise en IA entre les mains d'un petit nombre d'acteurs crée des rapports de dépendance cognitive entre nations, entreprises, et individus. Externaliser nos capacités de pensée, c'est potentiellement transférer une partie de notre souveraineté intellectuelle. Souveraineté, j'ai réussi à le placer héhéhé. C'est comme mot compte triple : ça ne veut rien dire de particulier mais c'est tellement redondant dans notre quotidien que ça fait effet... de rien en fait.
Une mémoire fragmentée : surcharge, distraction, dépendance
L'ère de la surcharge informationnelle
Contrairement à l'idée répandue d'un appauvrissement de la mémoire, l'usage intensif des technologies numériques produit souvent l'effet inverse : une saturation cognitive par excès d'information non hiérarchisée. Cette surcharge se manifeste par une multiplication chaotique des stimuli informationnels sans structure organisatrice cohérente.
Chaque jour, l'individu connecté moyen est exposé à plus de 34 gigabits d'information, soit l'équivalent de 100 000 mots selon les estimations de l'université de Californie San Diego. Cette exposition dépasse largement les capacités de traitement de notre système cognitif, conçu pour gérer des environnements informationnels beaucoup plus limités.
Cette surabondance sur-sollicite continuellement la mémoire de travail, cette fonction cognitive précieuse mais limitée qui permet de maintenir et manipuler temporairement l'information. George Miller avait identifié dès 1956 que cette mémoire ne peut traiter simultanément que 7 éléments environ (plus récemment révisé à 4 par Nelson Cowan ; espérons que la prochaine révision ne sera pas pour demain, c'est agaçant de penser qu'on sera moins bon que nos prédécesseurs tout de même). En l'absence de filtres efficaces, elle s'épuise à gérer un flux qui la dépasse structurellement.
Cette fatigue cognitive permanente ne se traduit pas seulement par une baisse de performance : elle modifie notre rapport au savoir lui-même. Face à l'abondance, nous développons des stratégies de survol et de tri rapide qui privilégient la quantité sur la qualité, la réactivité sur la réflexion, et surtout la rétention de ce qu'on a déjà accepté comme valide.
Fragmentation attentionnelle et mémoire volatile
La surabondance informationnelle s'accompagne d'un phénomène tout aussi problématique : la fragmentation attentionnelle. Les interfaces numériques, conçues pour maximiser l'engagement, multiplient les interruptions, les notifications, et les sollicitations concurrentes. C'est le business contre l'intellect. Rappelons une évidence quasi oubliée: l'iPad d'Apple n'a pas été conçu à l'origine comme un outil de production mais de consommation, contrairement aux discours tenus.
Cette architecture de la distraction empêche la consolidation mémorielle. Pour qu'une information passe de la mémoire de travail à la mémoire à long terme, elle doit bénéficier d'une attention soutenue pendant plusieurs secondes. Les interruptions fréquentes brisent ce processus, créant une mémoire superficielle et volatile.
Des recherches menées par Gloria Mark à l'université de Californie révèlent que le temps d'attention continue est passé de 2,5 minutes en 2004 à 75 secondes en 2012, puis à 47 secondes dans les mesures les plus récentes. Cette progression documentée sur près de deux décennies ne résulte pas d'une évolution cognitive naturelle, mais d'un conditionnement technologique qui privilégie la rapidité sur la profondeur. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis taquin alors : quelle différence entre le zapping TV des années 90, la zapping musical de l'ère IPod, le zapping Binge de l'ère des plateformes de streaming, le zapping des réseaux sociaux, le zapping des articles de blog de soi-disant intellectuels... heu bon là non je vais quand même pas me critiquer... ha bah non en fait je fais des articles tellement longs (volontairement, si si, pour lutter contre le nivelage systémique et le clientélisme, bref donner un temps long là où le "très très court" est devenu l'unique valeur promue et publiée) que si vous lisez ceci c'est que vous avez réussi à développer un trait évolutif garantissant votre survie dans le monde numérique. Félicitations !
Pour revenir à notre propos, cette fragmentation de l'attention produit ce que certains chercheurs nomment une mémoire en archipel : des îlots d'information isolés, faiblement connectés, rapidement oubliés. À l'opposé de la mémoire traditionnelle, organisée en réseaux sémantiques cohérents, cette mémoire fragmentée peine à générer du sens et des liens conceptuels durables.
Dépendance cognitive et anxiété informationnelle
La gestion de cette surcharge informationnelle génère paradoxalement une nouvelle forme de dépendance cognitive. Plus nous sommes submergés, plus nous nous tournons vers des outils automatisés pour trier, filtrer, et hiérarchiser l'information. Cette délégation, fonctionnelle à court terme, peut devenir problématique à long terme.
Les données Kaspersky révèlent que 64% des utilisateurs déclarent utiliser leurs appareils pour pouvoir se concentrer sur d'autres tâches, illustrant cette stratégie d'offloading cognitif. Cette tendance révèle une intolérance croissante à l'incertitude informationnelle. Incapables de supporter le doute ou l'ignorance temporaire, nous consultons compulsivement nos outils, créant un cercle vicieux de dépendance.
Cette anxiété informationnelle s'accompagne d'une perte de confiance en ses propres capacités cognitives. Des enquêtes montrent qu'une majorité d'étudiants déclarent douter de leurs réponses spontanées, même sur des sujets qu'ils maîtrisent, préférant systématiquement vérifier via leurs outils numériques.
Cette évolution transforme la phénoménologie de la connaissance : savoir devient synonyme de pouvoir vérifier, comprendre se confond avec pouvoir rechercher. Cette confusion conceptuelle peut altérer profondément notre rapport à l'autonomie intellectuelle et à la confiance cognitive. L'utilité du savoir redevient finalement un enjeu : savoir pour savoir ça ne tient pas la durée sauf structure mentale particulière.
Vers une mémoire désincarnée
Ces phénomènes convergent vers l'émergence d'une mémoire désincarnée : techniquement performante, mais déconnectée de l'expérience vécue et de la construction identitaire. Cette mémoire ressemble à un disque dur externe : accessible, organisé, mais étranger à la subjectivité de celui qui l'utilise.
Cette désincarnation pose des questions existentielles profondes. Si nos souvenirs, nos connaissances, et nos stratégies cognitives migrent vers des supports externes, que reste-t-il de notre intériorité mentale ? Peut-on encore parler d'une vie de l'esprit autonome ?
Certains philosophes, comme Yves Citton, y voient l'émergence d'une nouvelle forme de subjectivité, distribuée entre biologique et technologique. D'autres, comme Bernard Stiegler, alertent sur les risques de désappropriation de soi que cette évolution peut induire.
On pourrait ajouter que cette subjectivité sans investissement de notre responsabilité de sujet dans notre savoir ne sera pas sans conséquence dans notre capacité à assumer des responsabilités dans nos sociétés.
Penser la mémoire 3.0 : hybridation, pas substitution
Vers une mémoire stratégiquement hybride
Face aux défis posés par l'externalisation cognitive massive, l'enjeu n'est ni de revenir à un hypothétique âge d'or de la mémoire "pure", ni d'accepter passivement une délégation totale. Il s'agit de concevoir une mémoire 3.0 : hybride, consciente, stratégique, où humain et IA collaborent de façon complémentaire plutôt que substitutive. J'ai cherché une autre expression que 3.0 mais celle que je désirais ne va pas me faire de pub, c'était une mémoire qui ne serait pas du semblant. Je sais je taquine à nouveau.
Cette approche repose sur un principe fondamental : choisir délibérément ce qu'on externalise et ce qu'on conserve. Plutôt que de subir une externalisation par défaut, nous devons développer une capacité de curation cognitive qui distingue les fonctions à déléguer de celles à maintenir.
Concrètement, cela suppose de cartographier nos besoins cognitifs selon plusieurs critères :
Criticité : cette fonction est-elle essentielle à mon autonomie ?
Fréquence : est-ce que je l'utilise régulièrement ou occasionnellement ?
Complexité : nécessite-t-elle une expertise humaine irremplaçable ?
Créativité : contribue-t-elle à ma capacité d'innovation (notamment pour résoudre des problèmes que je rencontre pour la première fois) ?
Cette grille d'analyse permet de définir des zones de délégation consciente et des zones de préservation cognitive. Par exemple, externaliser la gestion de calendrier tout en maintenant sa capacité de calcul mental, ou déléguer la veille informationnelle tout en préservant sa capacité d'analyse critique.
Symbiose cognitive et intelligence augmentée
La mémoire 3.0 vise une symbiose cognitive où les forces respectives de l'humain et de l'IA se potentialisent (se renforcent) mutuellement. L'humain apporte l'intuition, la créativité, le sens éthique, la capacité d'adaptation ; l'IA fournit la puissance de calcul, la mémoire illimitée, la détection de patterns, la synthèse rapide.
Cette symbiose nécessite de repenser fondamentalement notre rapport aux outils cognitifs. Au lieu de les considérer comme des substituts à nos capacités, nous devons les concevoir comme des amplificateurs de nos facultés naturelles. L'objectif n'est pas de remplacer la pensée humaine, mais de l'augmenter. Hop deux fois que je le case aujourd'hui héhéhé.
Des expérimentations prometteuses émergent déjà dans cette direction. Des chercheurs du MIT ont développé des "cognitive partners" : des IA conçues non pour donner des réponses, mais pour poser de meilleures questions, identifier les biais de raisonnement, et suggérer des perspectives alternatives. Ces outils stimulent la réflexion plutôt que de la court-circuiter.
Architecture de la mémoire distribuée
La mémoire 3.0 s'appuie sur une architecture distribuée sophistiquée, où différents types d'information sont stockés et traités selon leurs spécificités. Cette distribution ne doit pas être subie, mais consciemment organisée selon une logique fonctionnelle.
Les connaissances procédurales (savoir-faire, automatismes, réflexes) restent avantageusement internalisées pour garantir la fluidité et l'autonomie. Les connaissances déclaratives factuelles peuvent être externalisées, à condition de maintenir une cartographie interne de leur localisation et de leur fiabilité.
Les métaconnaissances (savoir sur le savoir ; du coup je me demande ce que signifie réellement meta tout seul...) constituent le cœur de cette architecture. Elles comprennent la capacité à évaluer la qualité d'une source, à identifier ses propres lacunes, à choisir la stratégie cognitive appropriée selon le contexte. Ces métacompétences doivent impérativement rester internalisées car elles conditionnent l'usage intelligent de tous les autres outils.
Outils et pratiques de la mémoire consciente
La mise en œuvre de la mémoire 3.0 nécessite des outils spécifiquement conçus pour soutenir la cognition réflexive. Ces outils diffèrent fondamentalement des assistants traditionnels par leur philosophie : ils visent l'autonomisation plutôt que la dépendance. Un peu comme Socrate qui voulait enseigner "comment apprendre" plutôt que "quoi apprendre." Ça n'a pas été un succès au final.
Les systèmes de gestion des connaissances personnelles comme Obsidian, Roam Research, ou RemNote permettent de créer des "seconds cerveaux" structurés. Contrairement aux bases de données classiques, ces outils mettent l'accent sur les connexions sémantiques et la navigation conceptuelle, mimant le fonctionnement de la mémoire humaine.
Les assistants métacognitifs représentent une autre piste prometteuse. Ces IA spécialisées analysent nos patterns cognitifs, identifient nos biais, et proposent des stratégies d'amélioration. Plutôt que de nous donner des réponses, elles nous apprennent à mieux poser les questions.
Enfin, les protocoles de désintoxication cognitive émergent comme pratiques essentielles. Ces protocoles incluent des périodes de déconnexion volontaire, des exercices de mémorisation active, et des pratiques de réflexion autonome. L'objectif est de maintenir nos "muscles cognitifs" en forme, comme un athlète entretient sa condition physique. Oui on en est là...
La métacognition assistée : IA comme miroir cognitif
Redéfinir le rôle de l'IA : de l'automatisation à la réflexion
L'évolution la plus prometteuse dans notre relation à l'IA réside peut-être dans sa transformation d'outil d'automatisation en partenaire de réflexion. Cette mutation suppose de dépasser la logique de délégation pour développer des systèmes capables de stimuler et d'enrichir nos processus métacognitifs.
La métacognition – cette capacité à "penser sur sa pensée" (hé, tirets cadratins + parenthèses, je sais je taquine) – constitue l'une des facultés les plus sophistiquées de l'intelligence humaine. Elle englobe la conscience de ses propres processus cognitifs, la capacité à les évaluer, et la compétence pour les réguler. C'est précisément sur ce terrain que l'IA peut apporter sa contribution la plus précieuse.
Des plateformes expérimentales comme Reflect.app ou Mem.ai proposent déjà des fonctionnalités de coaching cognitif (le mot est lâché). Ces systèmes analysent nos patterns de pensée, identifient nos récurrences et nos angles morts, et posent des questions stimulantes : "Avez-vous envisagé cette perspective ?", "Quelles sont les hypothèses implicites de votre raisonnement ?", "Comment pourriez-vous vérifier cette conclusion ?"
Neurosciences de la métacognition et IA
Les recherches en neurosciences offrent un éclairage fascinant sur les mécanismes métacognitifs et leur possible interaction avec l'IA. Stephen Fleming et ses collègues ont identifié des circuits neuronaux spécifiques à la métacognition, notamment dans le cortex préfrontal antéro-latéral et l'insula.
Ces réseaux s'activent lorsque nous évaluons la qualité de nos propres jugements, estimons notre confiance dans une réponse, ou planifions nos stratégies cognitives. L'enjeu consiste à concevoir des IA qui stimulent ces circuits plutôt que de les court-circuiter.
Des expériences prometteuses suggèrent que l'interaction avec des systèmes métacognitifs peut effectivement renforcer ces capacités. Des étudiants utilisant des tuteurs IA métacognitifs développent de meilleures stratégies d'apprentissage et une conscience plus fine de leurs propres forces et faiblesses cognitives.
L'IA comme sparring-partner intellectuel (attention au KO)
Cette approche transforme radicalement la dynamique de l'interaction humain-machine. Au lieu d'une relation de dépendance (humain passif, IA active), nous développons une relation de partenariat cognitif (humain et IA actifs, complémentaires).
L'IA devient un sparring-partner intellectuel qui nous aide à affûter notre pensée par la contradiction constructive, la suggestion d'alternatives, et la mise en évidence de nos biais. Cette fonction de "contradicteur bienveillant" (je n'accepte ici aucune critique vu l'adoration devant cette sublime expression "neutralité bienveillante" si, comment dire, fausse... stupide... amusante... oui c'est ça) peut considérablement enrichir notre capacité de réflexion autonome.
Cette évolution est qualifiée par certains experts de "prochaine frontière de l'intelligence artificielle". Selon cette vision, les IA du futur ne se contenteront pas de traiter l'information, mais nous apprendront à mieux penser par nous-mêmes. Ce n'est pas pour aujourd'hui, on vous dit, c'est pour bientôt.
Développement de la vigilance cognitive
Cette métacognition assistée vise particulièrement le développement de ce que nous pourrions appeler la vigilance cognitive : cette capacité à maintenir un regard critique sur nos propres processus mentaux et sur les informations que nous recevons.
Dans un monde saturé d'informations et d'influences algorithmiques, cette vigilance devient cruciale. L'IA métacognitive peut nous aider à identifier nos biais de confirmation, à détecter les manipulations informationnelles, et à maintenir une indépendance intellectuelle face aux pressions du conformisme numérique.
Cette approche s'oppose diamétralement à la complaisance cognitive. Là où certains systèmes encouragent la passivité intellectuelle, l'IA métacognitive stimule au contraire l'auto-analyse, la responsabilité de penser, et l'autonomie critique.
Et puis imaginez une IA qui nous assisterait en éliminant de notre champ de vision tout ce qui est superflu, inutile, vide, non pertinent, marketing, publicitaire... là du coup vu ce qui restera je me demande si on aura encore besoin de l'IA pour nous assister... je sais je taquine mais malheureusement je suis convaincu que ma boutade est vraie au final. Dans une société de commerce mondialisé, que voulez-vous trouver d'autre que du commerce ?
Une écologie cognitive : comment préserver ce qui compte
Vers une sobriété mentale
La prolifération des outils cognitifs numériques nécessite de développer une véritable écologie cognitive : un ensemble de principes et de pratiques visant à préserver la santé de notre environnement mental (écologie, environnement, je n'ai pas pu m'empêcher, désolé). Cette approche s'inspire des mouvements de sobriété énergétique et de slow food, appliqués au domaine cognitif. Après tout le ridicule ne tue pas, donc on essaye.
Le premier principe de cette écologie consiste à ralentir délibérément nos interactions avec l'information. Face à l'accélération permanente des flux numériques, nous devons réapprendre la temporalité de la réflexion : laisser du temps à la maturation des idées, à la consolidation des apprentissages, à l'émergence de l'intuition. Un auteur de blog avec des articles de plus de 8000 mots héhéhé.
Cette démarche suppose de résister aux injonctions de rapidité véhiculées par nos outils. Les notifications immédiates, les réponses instantanées, les mises à jour continues créent une urgence artificielle qui épuise nos ressources attentionnelles. Une écologie cognitive privilégie les interfaces lentes, qui respectent nos rythmes biologiques et cognitifs naturels.
Curation cognitive et choix délibérés
L'écologie cognitive implique également de développer une compétence de curation : cette capacité à sélectionner, hiérarchiser, et organiser consciemment notre environnement informationnel. Dans un monde d'abondance, la rareté ne porte plus sur l'accès à l'information, mais sur l'attention disponible pour la traiter.
Cette curation opère à plusieurs niveaux :
Sélection des sources : privilégier la qualité à la quantité, la profondeur au survol (l'inverse des réseaux sociaux en quelque sorte)
Gestion des flux : organiser les rythmes de consultation, créer des plages de déconnexion
Filtrage intelligent : utiliser l'IA pour trier, mais conserver la décision finale de ce qui mérite notre attention (ici je pense que ça ne dépassera pas l'étape du vœu pieux).
L'objectif n'est pas de restreindre l'accès à l'information, mais de maîtriser cette exposition selon nos objectifs et nos valeurs. Cette maîtrise constitue une compétence démocratique essentielle dans une société numérique. Le terme démocratique s'entend uniquement dans le cas où l'on se sent encore appartenir à une société, ce n'est clairement pas gagné avec l'individualisme sans borne.
Équité cognitive et justice numérique
L'écologie cognitive soulève également des enjeux d'équité et de justice sociale. L'accès aux outils d'augmentation cognitive n'est pas uniformément distribué : il dépend des ressources économiques, du capital culturel, et de la littératie numérique. Nous l'avons déjà évoqué en mettant l'accent sur l'aspect financier, c'est à notre sens le plus discriminant.
Cette inégalité crée de nouvelles formes de stratification sociale basées sur les capacités cognitives augmentées. Ceux qui maîtrisent les outils d'IA peuvent démultiplier leurs capacités intellectuelles, creusant l'écart avec ceux qui en sont privés. Ou tout simplement rester dans le jeu.
Une écologie cognitive équitable suppose donc de démocratiser l'accès aux outils d'augmentation cognitive et de développer une éducation à la pensée augmentée accessible à tous. Cette éducation ne doit pas seulement enseigner l'usage des outils, mais aussi la capacité critique nécessaire à leur maîtrise. Oui je sais c'est du recyclage toutes ces bonnes intentions restées lettre morte qu'on nous rabâche depuis... houf tout ça ?
Préservation du patrimoine cognitif
Enfin, l'écologie cognitive implique de préserver ce que nous pourrions appeler notre patrimoine cognitif : ces compétences mentales fondamentales qui constituent le socle de notre humanité. Certaines capacités méritent d'être maintenues indépendamment de leur utilité immédiate, pour des raisons culturelles, éthiques, ou de sécurité.
La mémorisation, par exemple, ne se réduit pas à un stockage d'information. Elle participe à la construction de notre identité narrative et de notre autonomie intellectuelle. De même, le calcul mental développe des facultés de raisonnement qui dépassent les seules mathématiques.
Cette préservation nécessite un effort conscient et collectif. Elle suppose de maintenir des espaces cognitifs préservés : situations d'apprentissage sans assistance numérique, pratiques de mémorisation volontaire, exercices de réflexion autonome. Bref de la contrainte (sauf pour les fans de ces exercices), on a vu le résultat pour la maitrise de la grammaire. Le subjonctif maitrisé en CM1 dans les années 1970 est aujourd'hui non maitrisé en fin de collège. Et ce n'est qu'un exemple parmi une très, trop, grande quantité de faits semblables qui touchent tous les domaines de connaissances et de compétences.
Conclusion : retrouver la maîtrise de notre mémoire à l'ère de l'IA
Un tournant historique comparable au streaming culturel
L'intelligence artificielle ne détruit pas notre mémoire : elle la reconfigure en profondeur, créant de nouvelles possibilités tout en générant de nouveaux risques. Cette transformation s'inscrit dans une mutation plus large de notre rapport au savoir, comparable à celle qu'a connue la culture avec l'avènement du streaming.
Le parallèle est instructif. Lorsque Netflix, Spotify et leurs homologues ont rendu tous les contenus culturels accessibles instantanément, ils ont révolutionné notre consommation culturelle (initiée par Steve Jobs et l'iPod dans le domaine musical, on admire encore aujourd'hui les résultat sur l'industrie musicale, heu, c'est ironique hein). Mais cette révolution s'est accompagnée d'effets pervers : standardisation des goûts, baisse de la valeur symbolique des œuvres, passivité de la découverte remplacée par l'algorithme de recommandation. On peut ajouter désintérêt pour ce qui est devenu immédiatement accessible, donc sans valeur symbolique liée à l'attente, au désir, au plaisir.
L'abondance illimitée a paradoxalement engendré une médiocrité généralisée : des contenus formatés pour "plaire à tous" sans marquer personne. L'attente, l'effort de recherche, le plaisir de la découverte ont cédé place à une consommation passive et évanescente. Ça sonne mieux dit comme ça.
Cette logique menace aujourd'hui nos capacités cognitives. Ce que le binge-watching a fait au cinéma, l'externalisation cognitive non critique pourrait le faire à la pensée : une succession de souvenirs fragmentés, triés par des algorithmes selon leur capacité à séduire plutôt qu'à structurer notre compréhension du monde. ChatGPT est déjà reconnu pour sa trop grande propension à vouloir plaire à son abonné dans ses réponses.
Les enjeux existentiels de la mémoire externalisée
Au-delà des aspects fonctionnels, cette transformation interroge des dimensions existentielles fondamentales. Notre mémoire ne se contente pas de stocker des informations : elle constitue le tissu de notre être-temps, pour reprendre l'expression de Bernard Stiegler. Elle structure notre identité, nourrit notre imagination, guide nos décisions.
Quand nos souvenirs deviennent consultables plutôt qu'habités, quand nos connaissances résident dans des serveurs plutôt que dans notre esprit, quelque chose d'essentiel se transforme dans notre rapport au monde et à nous-mêmes. Nous risquons de développer une forme d'amnésie existentielle : techniquement connectés à tout, mais spirituellement déconnectés de nous-mêmes. Amnésie est utilisé ici pour éviter désengagement existentiel. On nous dit de ne pas trop exagéré dans les articles publics. C'est connu : les media n'exagèrent jamais !
Cette évolution soulève des questions que notre société n'a pas encore pleinement appréhendées. Peut-on développer une sagesse artificielle ou celle-ci nécessite-t-elle une mémoire incarnée ? La créativité peut-elle émerger d'une intelligence purement consultative ? L'empathie et l'intuition survivront-elles à la rationalisation algorithmique ?
Stratégies concrètes pour une mémoire maîtrisée
Face à ces défis, l'action devient urgente. Il ne s'agit pas d'adopter une posture passivement critique, mais de développer des stratégies concrètespour maintenir notre autonomie cognitive tout en bénéficiant des apports de l'IA.
Au niveau personnel, cela peut commencer par des pratiques simples mais essentielles :
Créer une mémoire personnelle cartographiée avec des outils comme Obsidian ou Logseq, qui permettent non seulement de stocker des idées, mais de tisser des liens sémantiques entre elles. L'objectif n'est pas de tout retenir, mais de construire un réseau conceptuel personnel qui enrichit notre compréhension plutôt que de la fragmenter. L'écueil sera le même que pour les fameuses cartes mentales : sans travail préparatoire approfondi, aucun gain à les utiliser.
Configurer son IA comme un partenaire réflexif plutôt qu'un moteur d'exécution. Lui demander : "Qu'est-ce que j'oublie dans ce raisonnement ?", "Y a-t-il des biais dans ma façon d'aborder ce problème ?", ou "Que devrais-je approfondir plutôt que déléguer ?". Cette approche transforme l'IA d'assistant passif en stimulateur de pensée critique.
Limiter volontairement les automatisations mentales en préservant certains domaines de compétence : ne pas déléguer systématiquement les anniversaires, les calculs simples, les références importantes. Car certaines informations doivent continuer à exister en nous, pas seulement près de nous. Enfin c'est ce qu'on peut raisonnablement soutenir aujourd'hui en 2025. N'oublions pas que les livres étaient encore diabolisés il n'y a pas si longtemps.
Au niveau collectif, cette démarche nécessite une mobilisation éducative et politique.
Repenser l'éducation pour développer la littératie cognitive : apprendre non seulement à utiliser les outils numériques, mais à comprendre leurs effets sur notre pensée et à maintenir notre autonomie intellectuelle (littératie quoi !).
Réguler l'économie de l'attention en encadrant les pratiques les plus prédatrices des plateformes numériques et en promouvant des interfaces respectueuses de nos rythmes cognitifs naturels.
Assurer des espaces cognitifs préservés dans l'éducation, le travail, et la vie sociale, où l'exercice de la pensée autonome reste valorisé et pratiqué.
L'horizon d'une intelligence authentiquement augmentée
L'enjeu ultime consiste à construire une intelligence authentiquement augmentée : ni purement biologique, ni intégralement déléguée, mais stratégiquement hybride. Cette intelligence maîtrise ses outils comme des extensions conscientes, sans jamais perdre de vue que la finalité de la pensée dépasse l'efficacité fonctionnelle.
Cette vision suppose de dépasser l'opposition stérile entre technophiles et technophobes pour développer une techno-sagesse : cette capacité à discerner quand et comment utiliser nos outils pour qu'ils nous servent plutôt que nous asservir.
Dans cette perspective, l'IA devient ce qu'elle devrait être : non un substitut à la pensée humaine, mais un amplificateur de nos facultés les plus précieuses. Elle nous libère des tâches routinières pour nous permettre de nous consacrer à ce qui fait notre spécificité : créer du sens, cultiver l'empathie, imaginer des futurs désirables, construire de la sagesse.
Il faut bien insister ici que le fait que nous ne pouvons soutenir ces propos que dans une vision de productivité dans les sociétés. Si nous nous plaçons du point de vue d'un retraité paisible, nous pourrions avantageusement poser la question de l'utilité de tout ce bazar qui continuerait de nous rendre spectateur de nos vies plutôt qu'acteur. Remarquons qu'attendre la retraite pour cela c'est un peu tard. N'oublions pas cette superbe formulation de Michel Audiard admirablement incarnée par Bernard Blier dans Les barbouzes : "...la retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. Ce n'est pas dans les moyens de tout le monde."
Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère cognitive. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si cette ère sera celle de l'augmentationou de la diminution de notre humanité. Il ne tient qu'à nous de faire de l'intelligence artificielle un allié de notre épanouissement plutôt qu'un agent de notre dépossession. Ceci sous la pression du groupe qui l'utilise, évidemment.
L'urgence n'est plus de débattre abstraitement de ces questions, mais d'agir concrètement dans nos pratiques quotidiennes. Les utilisateurs des outils IA ne nous ont pas attendu : cela fait plusieurs années que c'est en fonctionnement, probablement depuis 2019 pour l'aide à la rédaction et documentation. Je ne parle pas de prémisse imparfaite et de productions inutilisables, je parle de production professionnelle publiée. Donc nous pouvons continuer sur la vague de la nostalgie : que vont devenir nos enfants? Les GAFAM les ont eu. C'était mieux avant et autres passéisme couvert de bonnes intentions mais totalement hors sol. Le concret, le réel c'est les écrans, l'audiovisuel et l'IA. Il y a tout un monde dès à présent entre "avant 2018" et 2025. Les propos Éthique pour l'éthique sont importants, évidemment, mais se lamenter sur une situation présente et active depuis près de dix ans maintenant, cela devient aussi dangereux que de laisser faire silencieusement. C'est du moins mon opinion, d'où l'importance de se documenter, et de se souvenir que l'Éthique est personnelle, la Morale, elle, est collective avec toutes les traces historiques qu'elle n'a eu de cesse de laisser sur son passage (rarement bonnes, en fait je n'ai aucun exemple à vous donner d'une trace "bonne").
Bibliographie
Ouvrages de référence
Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The Extended Mind. Analysis, 58(1), 7-19.
Desmurget, M. (2019). La fabrique du crétin digital. Seuil.
Stiegler, B. (2010). Prendre soin de la jeunesse et des générations. Flammarion.
Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257-285.
Thompson, C. (2013). Smarter Than You Think: How Technology Is Changing Our Minds for the Better. Penguin Books.
Wegner, D. M. (1985). Transactive memory: A contemporary analysis of the group mind. Theories of group behavior, 185-208.
Articles scientifiques
Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences, 24(1), 87-114.
Coutrot, A., et al. (2023). Explaining World-Wide Variation in Navigation Ability from Millions of People Playing a Video Game. Topics in Cognitive Science, 15(1), 120-138.
Fleming, S. M., Weil, R. S., Nagy, Z., Dolan, R. J., & Rees, G. (2010). Relating introspective accuracy to individual differences in brain structure. Science, 329(5998), 1541-1543.
Fleming, S. M., & Dolan, R. J. (2012). The neural basis of metacognitive ability. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 367(1594), 1338-1349.
Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63(2), 81-97.
Oberauer, K., & Lewandowsky, S. (2011). Modeling working memory: a computational implementation of the Time-Based Resource-Sharing theory. Psychonomic Bulletin & Review, 18(1), 10-45.
Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. Trends in Cognitive Sciences, 20(9), 676-688.
Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. Science, 333(6043), 776-778.
Études et rapports récents
Avast. (2015). Digital amnesia and the smartphone generation. Rapport d'étude.
Kaspersky. (2015, mise à jour 2023). The rise and impact of digital amnesia. Rapport de recherche.
Université de Californie San Diego. (2021). Information overload in the digital age: Cognitive and behavioral impacts. Étude longitudinale.
Sources journalistiques spécialisées
Rodo, C. (2022). "L'effet Google ou comment Internet modifie notre mémoire". Atlantico, 15 mars.
Schechner, S. (2024). "How AI changed my language skills – and not for the better". The Wall Street Journal, 8 septembre.
Stern, J. (2025). "I tested voice recording devices for months. Here's what I learned about memory". The Wall Street Journal, 12 janvier.
The Decision Lab. (2023). The Google Effect: How search engines affect our memory. Analyse comportementale.
Ressources en ligne et plateformes
Center for Humane Technology. (2023). The attention crisis and cognitive wellbeing. Documentation en ligne.
Reflect.app, Mem.ai, Obsidian, Notion AI. Documentation technique et études d'usage.
Recherches en neurosciences
Mark, G., Gudith, D., & Klocke, U. (2008). The cost of interrupted work: more speed and stress. Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems, 107-110.
Mark, G., Iqbal, S., Czerwinski, M., Johns, P., & Sano, A. (2016). Neurotics can't focus: An in situ study of online multitasking in the workplace. Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1739-1744.
Philosophie et éthique de la technologie
Citton, Y. (2014). Pour une écologie de l'attention. Seuil.
Hayles, N. K. (2012). How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis. University of Chicago Press.
Simondon, G. (1958). Du mode d'existence des objets techniques. Aubier.
Éducation et pédagogie
Willingham, D. T. (2009). Why don't students like school? A cognitive scientist answers questions about how the mind works and what it means for the classroom. Jossey-Bass.
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
Prospective technologique
Kurzweil, R. (2005). The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. Viking.
Tegmark, M. (2017). Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. Knopf.