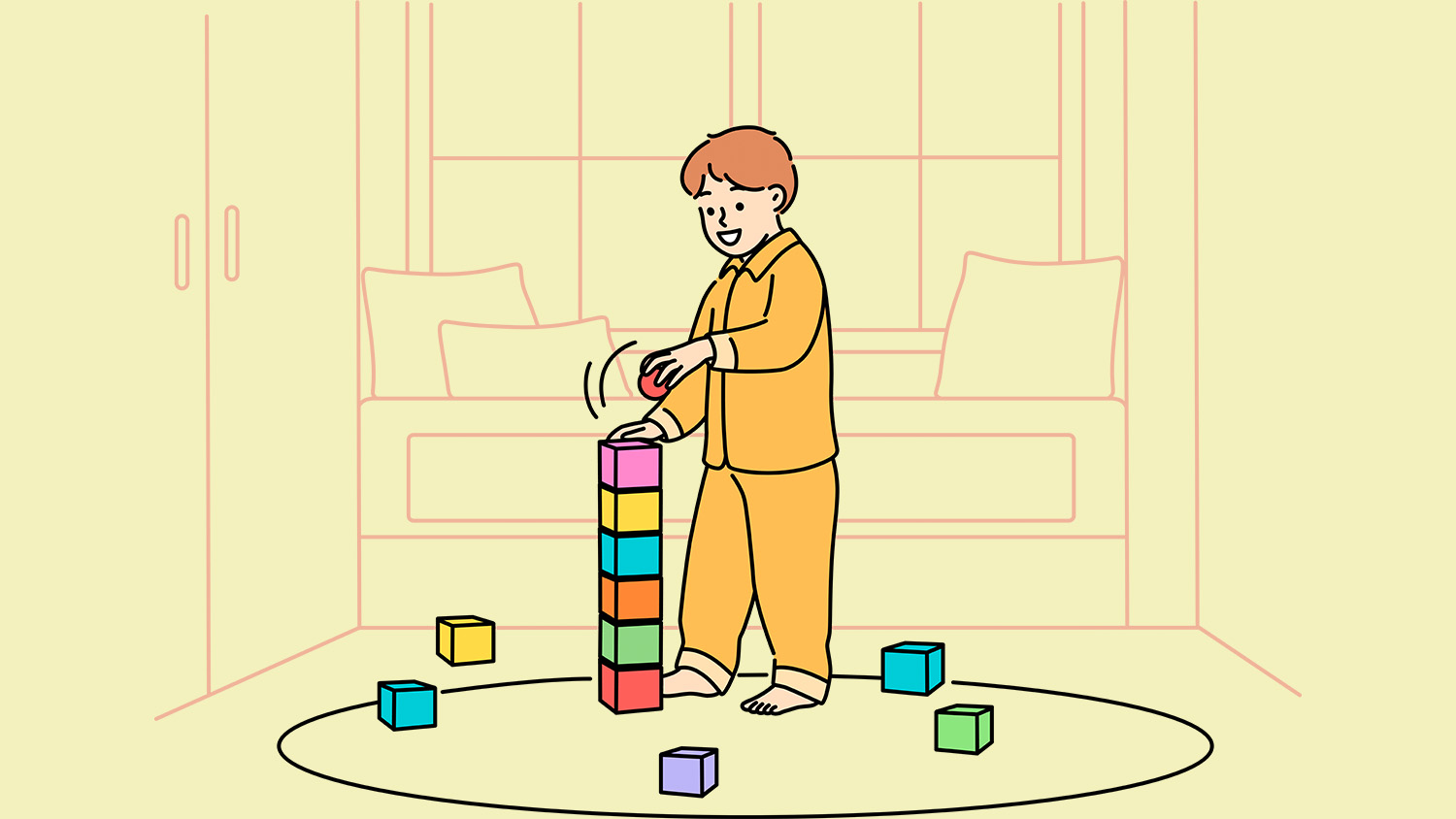
HPI le mythe lucratif : de l'invention du surdoué par Ajuriaguerra au business contemporain
Introduction : Un phénomène de société qui interroge
Depuis la diffusion de la série HPI avec Audrey Fleurot en 2021, les demandes de bilans psychométriques ont explosé en France. Sur Doctolib, de plus en plus de psychologues proposent désormais des évaluations HPI, facturées entre 200 et 600 euros. Derrière cette effervescence médiatique et commerciale se cache une réalité plus complexe : celle d'un concept aux fondements scientifiques fragiles, né dans un contexte historique particulier et transformé progressivement en produit de consommation.
Cet article propose une analyse approfondie de la construction historique du concept de "surdoué" puis de "haut potentiel intellectuel", depuis ses origines chez Julian de Ajuriaguerra en 1946 jusqu'à son exploitation commerciale contemporaine. Nous examinerons les filiations intellectuelles problématiques, notamment avec les travaux eugénistes de Lewis Terman, les faiblesses méthodologiques des tests psychométriques, et les dérives d'un marché en pleine expansion.
Cette analyse ne vise pas à nier les différences individuelles en matière de capacités cognitives, mais à questionner la validité scientifique et l'éthique des pratiques actuelles autour du diagnostic HPI. Comme le souligne Nicolas Gauvrit, chercheur à l'Université de Lille : "le business des surdoués est tout à fait juteux" et "il y aurait une véritable enquête journalistique à faire sur ce business".
I. La genèse historique : Julian de Ajuriaguerra et l'invention du "surdoué" (1946)
Le contexte de création
C'est en 1946, à Genève, que Julian de Ajuriaguerra introduit pour la première fois le terme "surdoué" dans le vocabulaire médical francophone. Neuropsychiatre d'origine basque, Ajuriaguerra définit alors le surdoué comme "l'enfant qui possède des aptitudes supérieures qui dépassent nettement la moyenne des capacités des enfants de son âge". Cette définition, apparemment simple, va marquer le début d'une longue histoire conceptuelle problématique.
Le parcours d'Ajuriaguerra est révélateur du contexte institutionnel de l'époque. Formé à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, il devient en 1959 titulaire de la chaire de psychiatrie de l'enfant à Genève, contribuant ainsi à la légitimation médicale de cette discipline émergente. Son approche s'inscrit dans un mouvement plus large de médicalisation et de catégorisation de l'enfance, caractéristique de l'après-guerre.
Une création terminologique historiquement située
L'invention du terme "surdoué" ne peut être comprise indépendamment du contexte socio-historique de l'époque. Les années 1940-1950 voient l'émergence d'une préoccupation croissante pour le repérage et la sélection des élites, dans une Europe en reconstruction. La notion de "don" naturel, héritée du XIXe siècle, se trouve ainsi médicalisée et institutionnalisée.
Il est crucial de noter qu'Ajuriaguerra ne travaillait pas dans un vide théorique. Ses travaux s'inscrivaient dans la continuité des recherches psychométriques américaines, notamment celles de Lewis Terman à Stanford. Cette filiation intellectuelle, rarement questionnée à l'époque, s'avérera particulièrement problématique au regard des découvertes ultérieures sur les biais et l'idéologie sous-jacente de ces travaux pionniers.
L'institutionnalisation progressive
La diffusion du concept de surdoué dans le système éducatif et médical français s'effectue progressivement. Les années 1960-1970 voient la création des premières associations de parents d'enfants "surdoués", contribuant à transformer une catégorie médicale en identité sociale. Cette évolution n'est pas neutre : elle participe à la naturalisation de différences qui sont en réalité largement construites socialement.
II. L'héritage toxique : De Terman à Ajuriaguerra
Lewis Terman : le père problématique de la douance
Pour comprendre les problèmes fondamentaux du concept de HPI, il est essentiel d'examiner les travaux de Lewis Terman (1877-1956), considéré comme le "père des surdoués" aux États-Unis. Professeur à Stanford, Terman adapte en 1916 le test Binet-Simon pour créer le Stanford-Binet, révolutionnant ainsi l'étiquetage scolaire et social des enfants. La douance fait référence à des capacités intellectuelles supérieures aux autres comparables (même tranche d'âge).
Comme le révèle le Stanford Magazine dans son article "The Vexing Legacy of Lewis Terman" (2000), l'héritage de Terman est profondément entaché par son idéologie eugéniste. Membre actif des sociétés eugénistes américaines, Terman était un fervent défenseur de la stérilisation forcée des personnes qu'il considérait comme "intellectuellement inférieures". Cette dimension idéologique n'était pas périphérique à ses travaux scientifiques : elle en constituait le fondement même.
L'étude longitudinale : un échec empirique révélateur
En 1921, Terman lance les "Genetic Studies of Genius", une étude longitudinale suivant 1528 enfants californiens identifiés comme "génies" (QI supérieur à 140). Cette recherche, qui se poursuivra pendant plus de 80 ans, devait démontrer la supériorité héréditaire de ces enfants et leur destinée exceptionnelle.
Les résultats de cette étude monumentale sont édifiants et contredisent totalement les hypothèses de Terman :
- Aucun Prix Nobel n'a été obtenu parmi les 1,528 "génies" sélectionnés
- William Shockley et Luis Alvarez, deux futurs Prix Nobel, avaient été exclus de l'étude car leur QI était jugé insuffisant
- L'étude d'Oden en 1968 révèle qu'il n'y avait aucune différence de QI entre les sujets ayant "réussi" et ceux ayant "échoué" dans la vie.
Les facteurs réellement prédictifs du succès se sont révélés être la confiance en soi, la persistance et le soutien parental : des éléments largement sociaux et environnementaux, non des caractéristiques innées mesurables par un test de QI.
Les manipulations méthodologiques
Plus grave encore, les archives révèlent que Terman intervenait directement dans la vie de ses sujets d'étude. Il écrivait des lettres de recommandation, facilitait des admissions universitaires, et influençait les trajectoires professionnelles de ses "génies". Cette intervention compromet radicalement la validité scientifique de ses conclusions, transformant l'étude en prophétie auto-réalisatrice.
La sélection initiale elle-même était profondément biaisée. Les enfants étaient majoritairement issus de familles blanches, aisées, avec des parents éduqués. Les minorités ethniques, les enfants de milieux défavorisés, et ceux présentant des difficultés d'apprentissage étaient systématiquement exclus. Cette homogénéité sociale de l'échantillon rend impossible toute généralisation sur l'intelligence humaine.
III. L'évolution sémantique : du surdoué au HPI
Les mutations terminologiques comme stratégie marketing
L'évolution du vocabulaire autour de la douance n'est pas anodine. Elle reflète des stratégies de repositionnement commercial et idéologique :
- 1946 : "Surdoué" (Ajuriaguerra) - connotation de don naturel
- Années 1990 : "Enfant intellectuellement précoce" (EIP) - accent sur le développement
- Années 2000 : "Haut Potentiel Intellectuel" (HPI) - technicisation du concept
- 2002 : "Zèbre" (Jeanne Siaud-Facchin) - métaphore poétique et commerciale
- 2019 : "Philo-cognitifs" (Fanny Nusbaum) - nouvelle segmentation du marché.
Cette prolifération terminologique n'est pas le signe d'un affinement scientifique, mais plutôt d'une recherche constante de nouveaux marchés. Chaque nouveau terme permet de relancer l'intérêt médiatique, de publier de nouveaux ouvrages, et de justifier de nouvelles formations et consultations.
Le phénomène "Zèbre" : un cas d'école
L'invention du terme "Zèbre" par Jeanne Siaud-Facchin illustre parfaitement cette dynamique commerciale. Son livre "L'enfant surdoué" est devenu un best-seller majeur, créant un véritable phénomène éditorial. La métaphore du zèbre (animal unique par ses rayures) véhicule l'idée d'une différence fondamentale, presque ontologique, entre les "HPI" et le reste de la population.
Cette approche pose plusieurs problèmes :
- Elle essentialise les différences cognitives
- Elle crée une identité figée basée sur un score de test
- Elle encourage une forme de séparatisme social
- Elle pathologise des variations normales du fonctionnement cognitif.
L'institutionnalisation administrative : la légitimation du tri social
L'Éducation nationale française a progressivement intégré ces concepts, créant des dispositifs spécifiques pour les "EIP" (Enfants Intellectuellement Précoces). Cette reconnaissance institutionnelle, si elle part d'une intention louable d'adaptation pédagogique, a paradoxalement renforcé la réification du concept et alimenté la demande de diagnostics.
Cette institutionnalisation a des effets pervers majeurs :
- Elle légitime scientifiquement un concept contestable
- Elle crée une pression sur les enseignants pour "détecter" les EIP
- Elle justifie la création de filières ségrégées dès le primaire
- Elle transforme une construction sociale en catégorie administrative officielle.
Le paradoxe est frappant : l'école républicaine, censée promouvoir l'égalité, participe ainsi à la naturalisation des inégalités en validant l'idée que certains enfants seraient intrinsèquement "supérieurs" et mériteraient un traitement particulier.
IV. L'analyse critique des fondements scientifiques
Les problèmes d'étalonnage : une imposture statistique
Les tests psychométriques utilisés pour diagnostiquer le HPI, comme le WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children, test de QI pour enfants de 6 à 16 ans) ou le WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale, test de QI pour adultes), souffrent de problèmes méthodologiques fondamentaux qui compromettent leur validité, particulièrement pour l'identification des scores extrêmes supposés caractériser les HPI.
Les autres batteries de tests : mêmes problèmes, mêmes dérives
Le WISC-V n'est pas un cas isolé. L'ensemble des batteries psychométriques utilisées pour diagnostiquer le HPI souffrent des mêmes défaillances structurelles :
Le WPPSI-IV (2 ans 6 mois - 7 ans 3 mois) : Test pour jeunes enfants présentant des problèmes identiques au WISC-V :
- Échantillons d'étalonnage insuffisants avec les mêmes biais de représentativité
- Biais culturels documentés : différences significatives entre enfants finlando-suédois et normes scandinaves
- Discordances majeures : jusqu'à 24 points de différence entre WPPSI-III et Leiter-R sur les mêmes enfants
- Performances significativement différentes selon les groupes sociaux, confirmant les biais de classe.
Le KABC-II (3-12 ans) : Présenté comme "culturellement équitable", ce test révèle en réalité :
- Les mêmes exclusions systématiques dans l'étalonnage (handicaps, minorités)
- Une validité structurelle problématique avec 2 modèles théoriques contradictoires (Luria vs CHC)
- Des biais culturels persistants malgré les prétentions d'équité
- Même fabricant, mêmes problèmes méthodologiques.
Le WAIS-IV (16-79 ans) : Pour les adultes cherchant un diagnostic tardif :
- Biais culturels documentés : performances systématiquement inférieures des groupes minoritaires
- Étalonnage français sur population WEIRD non représentative
- Mêmes problèmes de fiabilité que les tests pour enfants
- Même logique commerciale avec des coûts similaires.
Cette universalité des problèmes révèle qu'il ne s'agit pas de défauts corrigibles mais d'une impossibilité fondamentale de mesurer objectivement l'intelligence.
L'équation de la représentativité et ses implications
Sous ce titre obscure repose la raison qui à elle seule permet d'affirmer que tous les tests de QI sont non valides sauf coup de chance et je pèse mes mots.
La fiabilité statistique d'un test repose sur la qualité de son échantillon d'étalonnage. L'équation statistique fondamentale de la représentativité s'exprime ainsi : n = 0.25/(e/1.96)², où n est la taille de l'échantillon nécessaire et e la marge d'erreur acceptée.
Cette formule révèle l'ampleur du problème :
- Pour une précision de 95% avec une marge d'erreur de 1%, il faut 9,604 personnes
- Pour une marge d'erreur de 2%, il faut 2,401 personnes
- Pour une marge d'erreur de 3%, il faut 1,067 personnes
- Pour une marge d'erreur de 5%, il faut 384 personnes.
Or, la réalité des tests psychométriques est tout autre. Les échantillons d'étalonnage français comprennent généralement entre 400 et 800 personnes, ce qui implique une marge d'erreur réelle oscillant entre 3.5% et 5%. Cette imprécision devient catastrophique pour les scores extrêmes : pour les QI supérieurs à 130 (définition courante du HPI), les échantillons ne comptent souvent que 40 à 60 individus, portant la marge d'erreur à plus de 12%. Pour les QI supérieurs à 145, les normes reposent parfois sur 10 à 20 personnes maximum, rendant toute prétention à la précision absolument illusoire.
Cette faiblesse (euphémisme courtois) statistique est systématiquement dissimulée aux familles. Un psychologue annonçant un QI de 132 devrait honnêtement préciser : "Le score de votre enfant se situe quelque part entre 120 et 144, avec une probabilité de 95%". Une telle transparence révélerait immédiatement l'absurdité de fixer un seuil diagnostic précis à 130.
Pour les QI supérieurs à 130 (seuil HPI), les normes reposent souvent sur seulement 40 à 60 personnes, créant une marge d'erreur de plus de 12%. Concrètement : un enfant annoncé avec un QI de 130 pourrait en réalité avoir un QI entre 115 et 145. Impossible donc de dire s'il est réellement "HPI" ou pas.
Les exclusions systématiques : la fabrique d'une norme biaisée
Les échantillons d'étalonnage ne sont pas seulement insuffisants quantitativement ; ils sont aussi qualitativement biaisés par des exclusions systématiques :
Exclusions explicites documentées :
- Personnes avec handicaps physiques, sensoriels ou cognitifs (environ 15% de la population)
- Troubles d'apprentissage diagnostiqués : dyslexie, dyspraxie, TDAH (8-12% des enfants)
- Troubles psychiatriques ou neurologiques (20% de la population sur la vie entière)
- Parcours scolaires atypiques : redoublants, décrocheurs, scolarisation alternative (10-15%)
Exclusions implicites par biais de recrutement :
- Minorités culturelles et linguistiques sous-représentées (25-30% de la population dans les grandes villes)
- Milieux socio-économiques défavorisés (20% de la population sous le seuil de pauvreté)
- Zones rurales isolées (20% de la population française)
- Familles non francophones ou récemment immigrées (10-15%).
Le cumul de ces exclusions signifie que les normes sont établies sur moins de 40% de la population réelle. Comme le souligne Shuttleworth-Edwards (2016) avec une formule lapidaire : "Generally representative is representative of none" ("Ce qui est généralement représentatif ne représente personne"). Les tests mesurent donc la conformité à une norme construite sur une population WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic) minoritaire.
Les sophismes de la psychométrie : erreurs logiques fondamentales
Uher (2021) dans "Quantitative psychology under scrutiny" identifie plusieurs sophismes (raisonnements incorrects ayant une apparence de validité logique) qui minent les fondements épistémologiques de la psychométrie :
Le sophisme de réification
La réification consiste à traiter une abstraction statistique comme une réalité concrète. Le "facteur g" (intelligence générale), issu de l'analyse factorielle, est un artefact mathématique résultant de corrélations entre scores de tests. Pourtant, il est systématiquement présenté comme une entité neurologique réelle, voire comme "l'essence de l'intelligence".
Cette erreur logique est comparable à affirmer que la "taille moyenne des Français" existe physiquement quelque part. Le facteur g n'est qu'une construction statistique, pas une structure cérébrale identifiable. Les neurosciences n'ont jamais localisé de "centre de l'intelligence générale" dans le cerveau, qui fonctionne au contraire de manière distribuée et contextuelle.
La confusion signifiant-référent
Ce sophisme consiste à confondre le score (signifiant) avec la capacité qu'il prétend mesurer (référent). Un QI de 130 n'EST PAS l'intelligence ; c'est la performance à des tâches spécifiques, à un moment donné, dans des conditions particulières. Cette confusion est entretenue par le langage : on dit "avoir un QI de 130" comme on dirait "avoir les yeux bleus", suggérant une caractéristique intrinsèque et stable.
La réalité est que le QI mesure :
- La familiarité avec le format des tests
- La maîtrise de codes culturels spécifiques
- L'état physiologique et émotionnel du moment
- La motivation à réussir le test
- L'anxiété de performance
- La qualité de la relation avec l'examinateur.
Aucun de ces facteurs n'est "l'intelligence" en soi. Et pire : la négation de la qualité de la relation avec l'examinateur prétendument neutralisée avec les passations en triple aveugle ne font que sélectionner les enfants supportant le mieux la froideur des relations pour la passation ! La neutralité chez l'humain n'existe pas.
La circularité définitionnelle
L'intelligence est définie comme "ce que mesurent les tests d'intelligence", et les tests d'intelligence sont validés par leur capacité à mesurer "l'intelligence". Cette tautologie empêche toute validation externe réelle. C'est l'équivalent de définir la richesse comme "ce que mesure le compte en banque" puis de valider le compte en banque par sa capacité à mesurer la richesse, ignorant toutes les autres formes de capital (social, culturel, symbolique).
L'erreur d'inférence inverse
Cette erreur consiste à déduire l'existence d'une entité (le "haut potentiel") à partir de performances observées. C'est comme déduire l'existence d'un "gène du tennis" chez Roger Federer à partir de ses victoires. Les performances exceptionnelles à des tests peuvent résulter de multiples facteurs (entraînement, motivation, chance, contexte favorable...) sans nécessiter l'existence d'une caractéristique intrinsèque exceptionnelle.
La fragilité de la validité structurelle
Que mesure réellement le WISC-V ?
Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut savoir ce que prétend mesurer ce test central du diagnostic HPI. Le WISC-V évalue supposément cinq domaines de l'intelligence à travers quinze épreuves différentes :
Compréhension verbale (VCI)
- Épreuves types :
- Similarités : "Qu'ont en commun une pomme et une orange ?"
- Vocabulaire : "Que signifie le mot 'courage' ?"
- Information : "Combien y a-t-il de jours dans une année ?"
Raisonnement visuo-spatial (VSI)
- Épreuves types :
- Cubes : reproduire des motifs avec des cubes colorés
- Puzzles visuels : reconstituer mentalement des formes
- Complètement d'images : identifier ce qui manque dans une image
Raisonnement fluide (FRI)
- Épreuves types :
- Matrices : compléter des suites logiques visuelles
- Balances : résoudre des équations avec des symboles
- Arithmétique : résoudre des problèmes mathématiques oraux
Mémoire de travail (WMI)
- Épreuves types :
- Mémoire des chiffres : répéter des séquences de nombres
- Séquences lettres-chiffres : réorganiser des suites alphanumériques
Vitesse de traitement (PSI)
- Épreuves types :
- Code : associer rapidement symboles et chiffres
- Recherche de symboles : identifier rapidement des symboles cibles.
Chaque épreuve génère un score, et le test prétend fournir 15 indices différents pour "cerner le profil cognitif" de l'enfant. C'est sur cette base que les psychologues établissent leurs diagnostics HPI et leurs recommandations coûteuses.
Les scores fantômes du WISC-V
Les recherches de Watkins et Canivez (2019) sur la stabilité à long terme du WISC-V révèlent une réalité accablante pour les praticiens !
Sur les 15 scores possibles fournis par le WISC-V :
- Seulement 3 scores (VCI, VSI, FSIQ) atteignent le coefficient de fiabilité de 0.80 (seuil minimal pour qu'un test soit considéré comme fiable scientifiquement)
- Uniquement 2 scores (VCI et FSIQ) atteignent le standard de 0.90 recommandé pour les décisions cliniques individuelles
- Les 12 autres scores ont une fiabilité insuffisante même pour la recherche.
En termes simples : 80% des informations fournies par le test ne sont pas assez fiables pour fonder des décisions importantes sur la vie d'un enfant.
Pourtant, les bilans HPI utilisent systématiquement l'ensemble de ces scores pour établir des "profils cognitifs" censés révéler les spécificités de l'enfant. Les familles paient 400-600 euros pour des informations dont la grande majorité n'a pas la fiabilité statistique minimale pour fonder des décisions importantes. Cette réalité, jamais communiquée aux parents, révèle l'ampleur du problème.
L'illusion de la mesure multidimensionnelle
Le WISC-V prétend mesurer cinq dimensions de l'intelligence :
- Compréhension verbale
- Raisonnement visuo-spatial
- Raisonnement fluide
- Mémoire de travail
- Vitesse de traitement.
Les analyses factorielles confirmatoires montrent que cette structure ne tient pas empiriquement. Les corrélations entre ces supposées dimensions indépendantes varient de 0.60 à 0.85, suggérant qu'elles mesurent largement la même chose. La prétention à fournir un "profil cognitif détaillé" est donc scientifiquement infondée. J'ajoute que chaque dimension est une hypothèse qui repose sur des hypothèses : nous n'avons aucune idée ou information directe et fiable sur la nature de la mémoire, l'existence d'un raisonnement verbal, tout simplement parce que nous ignorons à quelle échelle et sur quel substrat repose ces "hypothèses". C'est aussi simple que cela, mais dit ainsi c'est beaucoup moins vendeur.
Les biais culturels : une discrimination systémique masquée
L'ampleur documentée du problème
L'American Psychological Association et de multiples études indépendantes convergent : Les tests psychométriques exhibent des biais culturels significatifs. Cette statistique, rarement communiquée aux familles, signifie que la grande majorité des outils diagnostiques favorisent systématiquement certains groupes sociaux au détriment d'autres.
Anatomie des biais linguistiques
Les biais linguistiques opèrent à plusieurs niveaux, créant un avantage cumulatif pour les enfants de milieux privilégiés :
Le vocabulaire académique spécialisé
Les subtests verbaux du WISC/WAIS utilisent un vocabulaire particulier. Par exemple, le subtest "Similarités" demande d'expliquer ce qu'ont en commun des paires de mots. Les items progressent de concepts concrets ("pomme-banane") vers des abstractions ("liberté-justice"). Un enfant de milieu favorisé, exposé quotidiennement à des discussions abstraites lors des repas familiaux, possède un avantage décisif sur un enfant dont les parents, même intelligents, utilisent un langage plus pragmatique.
Les structures syntaxiques complexes
Les consignes et questions utilisent des structures grammaticales sophistiquées : propositions subordonnées multiples, voix passive, conditionnels complexes. Ces structures, maîtrisées naturellement dans les milieux éduqués, peuvent dérouter des enfants tout aussi intelligents mais socialisés dans des contextes linguistiques différents.
Les registres de langue valorisés
Le test valorise implicitement le registre soutenu. Un enfant utilisant un vocabulaire familier ou régional, même riche et créatif, sera pénalisé. L'intelligence vernaculaire - la capacité à jouer avec les mots, créer des néologismes, manier l'humour populaire - n'est pas reconnue.
La violence symbolique des biais de contenu
Les biais de contenu révèlent l'ancrage culturel profond et non questionné des concepteurs de tests :
Les situations de référence ethnocentrées
Les problèmes mathématiques parlent de :
- Voyages en avion (inaccessibles à 40% de la population)
- Achats dans des centres commerciaux (absents en milieu rural)
- Activités de loisirs coûteuses (cours de piano, équitation)
- Technologies supposées universelles (ordinateurs, smartphones haut de gamme).
Un enfant rural ou de milieu populaire doit d'abord traduire mentalement ces situations étrangères avant de pouvoir résoudre le problème, créant une charge cognitive supplémentaire absente pour les enfants de milieux favorisés.
Les valeurs individualistes implicites
Les tests valorisent :
- La compétition plutôt que la coopération
- L'affirmation de soi plutôt que l'harmonie du groupe
- La rapidité plutôt que la réflexion approfondie
- L'abstraction plutôt que le pragmatisme
Ces valeurs, typiques des classes moyennes et supérieures occidentales, sont présentées comme universelles. Un enfant issu d'une culture valorisant la modestie et la réflexion collective sera structurellement désavantagé.
Les références culturelles cachées
De nombreux items contiennent des références culturelles implicites :
- Contes et histoires de la culture dominante
- Expressions idiomatiques ("avoir plusieurs cordes à son arc")
- Concepts religieux ou philosophiques occidentaux
- Références historiques "eurocentrées".
Un enfant d'origine immigrée, même né en France, peut ne pas partager ces références, non par manque d'intelligence mais par différence de bagage culturel familial.
V. L'attrait des explications simplistes : pourquoi les mythes perdurent
L'illusion de la simplicité cognitive
La persistance du concept HPI, malgré ses faiblesses scientifiques accablantes, s'explique par des mécanismes psychologiques profonds. L'être humain privilégie naturellement les explications simples et rassurantes aux analyses complexes et nuancées. Cette tendance, documentée par la psychologie cognitive, explique pourquoi des concepts simplistes comme le QI unique continuent de séduire malgré leur invalidation scientifique.
Le mythe révélateur du "cerveau gauche/cerveau droit"
L'exemple du mythe "cerveau gauche analytique, cerveau droit créatif" illustre parfaitement cette dynamique. Malgré des décennies de neurosciences démontrant que les deux hémisphères cérébraux collaborent étroitement pour toutes les tâches cognitives, ce neuromythe persiste dans l'imaginaire collectif. Les études d'imagerie cérébrale montrent que même les tâches supposées "latéralisées" comme le langage mobilisent les deux hémisphères de manière coordonnée.
Pourquoi ce mythe survit-il ? Parce qu'il offre :
- Une catégorisation binaire simple : on est "cerveau gauche" ou "cerveau droit"
- Une explication flatteuse des difficultés : "Je suis nul en maths car je suis cerveau droit"
- Une identité cognitive rassurante : appartenance à un groupe défini
- Une illusion de compréhension du fonctionnement cérébral complexe.
Le parallèle avec le HPI est frappant. Le concept de HPI offre exactement les mêmes bénéfices psychologiques : catégorisation simple (HPI ou non), explication des difficultés (inadaptation du système aux "surdoués"), identité valorisante (faire partie des "2%"), et illusion de compréhension de l'intelligence. CQFD !
La séduction de l'exceptionnalité
Le diagnostic HPI répond à un besoin psychologique fondamental : celui de se sentir unique et spécial. Dans une société de masse où l'individu peut se sentir noyé dans l'anonymat, l'étiquette HPI offre une distinction immédiate et prestigieuse.
Cette séduction opère à plusieurs niveaux :
La flatterie narcissique
Être diagnostiqué HPI, c'est être officiellement reconnu comme "supérieurement intelligent". Cette validation externe d'une supériorité supposée nourrit le narcissisme, particulièrement dans une société obsédée par la performance et la réussite. Ceci est me semble-t-il surtout valable pour les parents qui veulent faire reconnaître leur enfant comme "HPI".
L'appartenance à une élite
Le HPI crée une communauté imaginaire d'individus exceptionnels. Les groupes Facebook "HPI", "Zèbres" ou "Surdoués" comptent des centaines de milliers de membres qui partagent le sentiment d'appartenir à une élite incomprise. Ça me rappelle la blague de Groucho Marx (citation approximative) : "Vous voudriez que je fasse partie d'un club qui accepterait des gens tels que moi ?"
La légitimation de l'échec
Paradoxalement, le diagnostic HPI peut aussi servir à expliquer et excuser les échecs. "Mon enfant échoue à l'école car il est trop intelligent pour le système" est plus acceptable que "mon enfant a des difficultés d'apprentissage ordinaires". Hé oui, il ne faut pas oublié que le principal indice pour lancer une détection de "HPI" dans la majorité des cas n'est pas l'excellence des résultats scolaires mais l'échec.
Le biais de confirmation généralisé
Une fois le concept HPI intégré, un puissant biais de confirmation s'installe. Tout comportement de l'enfant est interprété à travers le prisme du HPI :
- L'enfant s'ennuie en classe ? C'est parce qu'il est HPI
- Il a des difficultés sociales ? C'est le syndrome du HPI
- Il est anxieux ? C'est l'hypersensibilité du HPI
- Il réussit ? Cela confirme son HPI
- Il échoue ? C'est l'inadaptation du système au HPI.
Cette grille de lecture totalisante empêche toute remise en question. Les comportements qui contrediraient le diagnostic sont ignorés ou réinterprétés pour maintenir la cohérence cognitive. C'est la plus belle invention marketing je trouve : même dans l'échec c'est vendeur.
VI. Le business model contemporain
L'explosion du marché post-série HPI
La diffusion de la série HPI avec Audrey Fleurot en 2021 marque un tournant dans la commercialisation du concept. L'analyse du marché révèle une explosion sans précédent de la demande et une structuration industrielle de l'offre.
Les chiffres d'un marché en pleine expansion
Les données collectées révèlent l'ampleur économique du phénomène :
Volume d'activité :
- 10% des psychologues (fourchette basse d'estimation basée sur les professionnels formés à la passation des tests) proposent des bilans HPI (environ 10000 praticiens)
- 30,000 à 50,000 bilans HPI réalisés annuellement en France (estimation basse)
- Délais d'attente : 3 à 6 mois dans les grandes villes
- Taux de croissance : +40% par an depuis 2021
Structure tarifaire standard :
- Consultation initiale : 80-120€ (45-60 minutes)
- Passation des tests : 350-500€ (2-3 heures)
- Analyse et compte-rendu : 80-150€ (1 heure)
- Total moyen : 510-770€ (fourchette basse) par bilan complet.
Les mécanismes de captation et de pathologisation
Le système HPI fonctionne comme un entonnoir commercial sophistiqué, transformant systématiquement l'anxiété parentale (ou le désir de reconnaissance) en revenus pour les professionnels du secteur. Cette captation opère à trois niveaux complémentaires :
1. La captation massive via l'auto-diagnostic en ligne
Les "tests de QI gratuits" en ligne constituent la porte d'entrée du système, avec une stratégie manipulatoire bien rodée :
Volume et conversion :
- 5-10 millions de tests réalisés annuellement en France (je considère que c'est une estimation car une même personne peut s'amuser à les passer et repasser plusieurs fois)
- Beaucoup de tests donnent des résultats "élevés" (QI 115-135) indépendamment des réponses (c'est pourquoi les professionnels sont unanimes pour dire que ces tests en ligne ne sont pas fiables)
- Message anxiogène systématique : "Votre potentiel pourrait être sous-exploité" et autres déclinaisons du "avec notre aide vous pourriez être mieux classé"
Mécanismes psychologiques exploités :
- Questions flatteuses garantissant l'identification ("Avez-vous souvent des idées originales ?")
- Effet Barnum (ou Forer selon les goûts) : descriptions vagues paraissant personnalisées
- Biais de confirmation : l'utilisateur trouve ce qu'il cherche
- Urgence artificielle : "Ne laissez pas votre potentiel inexploité".
2. La pathologisation systématique de la normalité
Tout trait de personnalité normal devient suspect et nécessite une "investigation professionnelle" :
Transformations sémantiques opérées :
- Curiosité intellectuelle → "Soif pathologique de connaissance du HPI"
- Sensibilité émotionnelle → "Hypersensibilité caractéristique des zèbres"
- Perfectionnisme → "Syndrome de l'imposteur du surdoué"
- Timidité → "Décalage social typique du haut potentiel"
- Ennui occasionnel → "Sous-stimulation chronique nécessitant diagnostic"
- Anxiété normale → "Anxiété existentielle du HPI"
- Rêverie → "Pensée en arborescence pathologique"
- Opposition → "Comportement défiant typique du surdoué incompris".
Cette pathologisation transforme pratiquement toute famille en cliente potentielle : quel enfant ne présente pas au moins l'un de ces traits parfaitement normaux ?
3. L'entretien de la dépendance commerciale
Une fois la famille entrée dans le système, des mécanismes de rétention s'activent :
- Multiplication des bilans "complémentaires" (psychomoteur, orthophonique, créativité)
- Suivis thérapeutiques présentés comme indispensables ou très fortement conseillés
- Orientation vers des "spécialistes" partenaires
- Culpabilisation en cas d'arrêt ("Vous négligez le potentiel de votre enfant" ou moins brutal "oui je respecte votre choix et ses implications").
Les conflits d'intérêts structurels
Le système HPI fonctionne avec des conflits d'intérêts omniprésents mais rarement explicités :
La confusion des rôles
Le même professionnel cumule souvent plusieurs rôles :
- Prescripteur (recommande le test)
- Évaluateur (fait passer le test)
- Interprète (analyse les résultats)
- Thérapeute (propose le suivi)
- Formateur (vend des formations).
Cette concentration crée une incitation économique évidente à maximiser les diagnostics positifs et les suivis prolongés.
L'absence de contre-expertise
- Pas de second avis systématique
- Absence de révision par les pairs
- Aucun contrôle de qualité externe
- Pas de suivi des taux de diagnostic par praticien.
Un psychologue diagnostiquant 90% de HPI parmi ses consultants (taux anormalement élevé) ne fait l'objet d'aucun contrôle. Les familles souhaitant un second avis pour leur discernement doivent investir à nouveau dans une dépense importante, ça freine beaucoup.
VII. L'idéologie néolibérale : quand la performance devient norme
Le HPI comme symptôme du capitalisme tardif
Le succès du concept HPI ne peut être compris indépendamment de l'idéologie néolibérale dominante. Dans un système qui a fait de la performance individuelle mesurable la nouvelle religion, le QI devient le Saint Graal de la réussite promise.
La marchandisation de l'enfance
Dans la logique néolibérale, l'enfant devient un produit à optimiser. Cette vision, analysée par les sociologues de l'éducation, transforme radicalement le rapport à l'enfance :
L'enfant-investissement Les parents, confrontés à un marché du travail précarisé et ultra-compétitif, voient dans leur enfant un investissement à rentabiliser. Le diagnostic HPI devient alors :
- Un avantage concurrentiel dans la course scolaire
- Une assurance contre le déclassement social
- Un capital symbolique monnayable
- Une justification des investissements éducatifs (écoles privées, cours particuliers)
La quantification obsessionnelle Le néolibéralisme impose la quantification de toute valeur. L'intelligence, réduite à un score, devient :
- Comparable : mon enfant a 135, le vôtre 125
- Échangeable : un QI élevé "vaut" une place en école d'élite
- Optimisable : on peut "travailler" son QI avec des entraînements
- Rentabilisable : investir dans le diagnostic pour maximiser le "retour".
L'économie de l'attention appliquée aux enfants
Les enfants sont soumis dès le plus jeune âge à une économie de l'attention impitoyable. Dans ce système :
La performance permanente
- Tests dès la maternelle
- Évaluations continues
- Classements constants
- Compétition généralisée.
Cette pression évaluative constante crée ce qu'on pourrait appeler une "maltraitance douce" : pas de violence physique, mais une violence symbolique permanente qui transforme l'enfance en parcours d'obstacles psychométriques.
La culpabilisation parentale Les parents sont pris dans un "double bind" (concept introduit par G. Bateson et son équipe de Palo Alto dans les années 1950 pour désigner "un dilemme communicatif résultant de la contradiction entre deux ou plusieurs messages") :
- S'ils ne font pas tester leur enfant, ils "négligent son potentiel"
- S'ils le font tester et qu'il n'est pas HPI, ils doivent affronter leur "déception"
- S'il est diagnostiqué HPI, ils doivent "être à la hauteur" de ce potentiel.
Cette culpabilisation permanente alimente le marché : les parents anxieux consomment tests, livres, formations, thérapies. Tout comme celles désirant la reconnaissance.
La naturalisation (banalisation voulais-je écrire) des inégalités sociales
Le concept HPI joue un rôle idéologique crucial : il naturalise les inégalités sociales en les attribuant à des différences biologiques innées.
Le mythe méritocratique renforcé
Dans la mythologie néolibérale, chacun obtient ce qu'il mérite selon ses capacités. Le HPI vient "scientifiquement" confirmer ce mythe :
- Les riches sont riches car plus intelligents (HPI surreprésentés dans les classes favorisées)
- Les pauvres sont pauvres par manque de "potentiel"
- Les inégalités sont justes car basées sur des différences "naturelles".
Cette naturalisation ignore systématiquement :
- Le rôle du capital économique dans l'accès aux tests
- L'importance du capital culturel dans la réussite aux tests
- Les biais de classe des tests eux-mêmes
- La reproduction sociale masquée derrière le "mérite".
La violence symbolique institutionnalisée
L'école, en adoptant le concept HPI, participe à cette violence symbolique avec un discours tacite qui s'insinue dès le départ :
Ségrégation scolaire légitimée
- Classes pour "EIP" (enfants intellectuellement précoces)
- Parcours différenciés dès le primaire
- Orientation précoce basée sur les tests
- Abandon "en creux" du projet d'école inclusive
Hiérarchisation cognitive officielle
- Les "HPI" méritent une pédagogie spéciale
- Les "normaux" doivent accepter leur médiocrité
- Les "faibles" sont orientés vers des filières dévalorisées.
Cette hiérarchisation, présentée comme scientifique et bienveillante, masque une ségrégation sociale brutale. Je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec toutes les difficultés que rencontrent les familles d'enfants présentant un handicap à le maintenir dans le parcours dit "normal" d'éducation avec les autres élèves.
L'aliénation cognitive généralisée
Le système HPI participe à une forme d'aliénation spécifique au néolibéralisme : l'aliénation cognitive.
L'intériorisation de la domination
Les individus intériorisent leur position dans la hiérarchie cognitive comme naturelle et méritée :
- Les "HPI" intériorisent leur supériorité (et l'anxiété qui l'accompagne)
- Les "non-HPI" intériorisent leur infériorité (et la résignation associée)
- Tous acceptent le système de mesure comme légitime.
La compétition destructrice
La logique HPI installe une compétition permanente entre enfants, entre parents, entre écoles :
- Course aux meilleurs scores
- Surenchère diagnostique
- Inflation des seuils (130 ne suffit plus, il faut 140, puis 150, j'ai même rencontré des personnes qui m'annonçaient sans broncher des QI de 180 ou 220...)
- Épuisement généralisé.
Cette compétition, loin de stimuler l'excellence, produit :
- Anxiété massive chez les enfants
- Burn-out parental
- Dégoût de l'apprentissage
- Perte du plaisir de découvrir.
Je sais que ça ne va pas plaire, mais tous ces mécanismes observés et observables par chacun me font penser à ceux des thèses racistes, comme si la ségrégation (peu important sur quoi elle repose et ce qu'elle vise) se nourrissait toujours exclusivement de la même chose.
VIII. Les victimes collatérales et les dérives systémiques
L'impact dévastateur sur les familles
Le coût financier : une spirale d'endettement
L'engagement dans le parcours HPI représente pour de nombreuses familles un gouffre financier progressif :
Phase 1 : Le diagnostic initial (500-800€, j'en ai même trouvé sur Paris à 1200€ avec investigations complémentaires possibles voire conseillées selon les résultats de l'évaluation primaire)
- Bilan psychométrique complet
- Souvent non concluant, nécessitant un second avis
- Multiplication des consultations "pour être sûr"
Phase 2 : Les évaluations complémentaires (1,000-3,000€)
- Bilan psychomoteur "pour comprendre les décalages"
- Bilan orthophonique "pour les troubles associés"
- Bilan neuropsychologique "pour affiner le profil"
- Tests de créativité, tests émotionnels
Phase 3 : Les suivis thérapeutiques (de 50-100€ la séance à des forfaits de 2,000-5,000€/an)
- Psychothérapie spécialisée HPI
- Groupes de socialisation pour "zèbres"
- Coaching parental
- Ateliers de gestion émotionnelle
Phase 4 : La scolarité adaptée (5,000-20,000€/an, coûts moyens observés mais pouvant aller largement au-delà)
- École privée spécialisée HPI
- Cours particuliers pour "nourrir le potentiel"
- Activités extrascolaires "stimulantes"
- Stages et camps de vacances HPI
Coût total sur une scolarité : 50,000 à 200,000€
Pour les familles modestes, cet investissement peut signifier :
- Endettement via crédit à la consommation
- Sacrifices sur d'autres postes (vacances, loisirs)
- Tensions conjugales sur les priorités financières
- Culpabilité de ne pas "faire assez".
En fait dans la majorité des cas cela s'arrête à la culpabilité définitivement acquise de n'avoir pu porter son enfant dans son plein potentiel. Tout ça pour un concept reposant sur du vent précisé par des tests statistiquement non valables pour toutes les raisons que nous avons déjà passées en revue.
Le syndrome de l'imposteur inversé : la quête identitaire pathologique
Un phénomène particulièrement préoccupant émerge : des adultes cherchant désespérément à obtenir l'étiquette HPI pour valider leur sentiment de différence.
Le parcours type du "chercheur de diagnostic" :
- Découverte du concept via média ou témoignage
- Auto-identification massive ("je me reconnais dans tous les signes")
- Tests en ligne confirmant le "soupçon"
- Première consultation : résultat négatif ou limite
- Contestation du résultat ("le psy n'était pas compétent")
- Consultations multiples jusqu'à obtention du diagnostic souhaité
- Investissement identitaire total dans le label HPI.
Ce parcours peut coûter plusieurs milliers d'euros et des années de quête obsessionnelle. Les forums HPI regorgent de témoignages d'adultes ayant consulté 5, 10, voire 15 professionnels différents avant d'obtenir "enfin" leur diagnostic. C'est en ligne vous pouvez les lire soit dans les forums de discussion soit sur les réseaux sociaux.
Les dérives professionnelles : l'absence totale de régulation
Le far-west diagnostique
Le marché du HPI opère dans un vide réglementaire quasi-total, permettant toutes les dérives :
Praticiens non qualifiés
- Coachs s'autoproclament "spécialistes HPI" sans formation psychologique
- Psychologues sans formation spécifique aux tests utilisent des outils qu'ils ne maîtrisent pas
- Thérapeutes "alternatifs" proposent des "diagnostics énergétiques" de douance (si j'ai moi-même été surpris de tomber sur cela, là encore vous pouvez les retrouver grace à votre moteur de recherche préféré sur le net)
Interprétations fantaisistes
- Surinterprétation des scores ("votre enfant est un génie incompris")
- Invention de catégories ("HPI à dominante créative émotionnelle")
- Diagnostics sur des bases non scientifiques (dessins, intuition)
Promesses mensongères (le terme semble fort mais comment peut-on sans mentir annoncer ce qui suit)
- "Révélez le génie de votre enfant"
- "Méthode garantie pour développer le HPI"
- "Transformation en 10 séances".
Au milieu de tout cela, des professionnels consciencieux, diplômés et avec une solide expérience clinique se retrouvent à patauger dans l'honnêteté quand une famille les consulte et qu'ils répondent honnêtement que ce concept de HPI est très peu soutenu scientifiquement (c'est un euphémisme), qu'il risque de stigmatiser une famille qui n'obtient pas les résultats escomptés, qu'il ne prédit en rien de la réussite d'un enfant dans sa vie...
Les pratiques commerciales prédatrices
L'upselling systématique Après le diagnostic initial, multiplication des propositions :
- "Il faudrait approfondir avec un bilan complémentaire"
- "Un suivi régulier est indispensable pour ces profils"
- "Je vous recommande mon collègue spécialiste"
La rétention de clientèle Création d'une dépendance thérapeutique :
- "Les HPI ont besoin d'un accompagnement au long cours"
- "Arrêter maintenant serait préjudiciable"
- "Votre enfant régresse sans suivi"
Le fear marketing (la peur qui fait vendre) Dramatisation des conséquences du non-diagnostic :
- "Sans prise en charge, risque de dépression"
- "Les HPI non détectés développent des addictions"
- "Votre enfant pourrait décrocher scolairement".
Ça fait quand même beaucoup, et malgré tout cela ce concept existe et séduit, que penser de nous et de nos sociétés à ce point ?
L'impact sociétal : la fabrique d'une société fragmentée
La destruction du socle commun scolaire
L'obsession HPI contribue à la fragmentation du système éducatif :
Multiplication des dispositifs ségrégués
- Classes EIP dans le public
- Écoles privées spécialisées
- Dispositifs de "saut de classe"
- Parcours individualisés
Cette fragmentation :
- Détruit la mixité sociale et cognitive
- Concentre les moyens sur une minorité
- Abandonne la majorité des élèves
- Légitime l'échec scolaire des "non-HPI".
L'abandon du projet inclusif L'école inclusive, qui devrait accueillir tous les profils d'apprentissage, est remplacée par une école ségrégative qui trie et catégorise dès le plus jeune âge.
La souffrance des "non-élus"
Pour chaque enfant diagnostiqué HPI et valorisé, combien d'enfants intériorisent leur "infériorité" ?
Les dommages collatéraux invisibles :
- Frères et sœurs "non-HPI" vivant dans l'ombre
- Camarades de classe étiquetés implicitement "moins intelligents"
- Parents culpabilisant de ne pas avoir d'enfant "surdoué"
- Enseignants démotivés face aux élèves "ordinaires".
Cette souffrance silencieuse, non comptabilisée, représente le coût social réel du système HPI. Et je ne fais que l'esquisser, elle mériterait un article dédié.
IX. Déconstruire les sophismes : pour une critique épistémologique radicale
Au-delà de la critique empirique
Si les problèmes méthodologiques des tests sont accablants, ils ne constituent que la surface du problème. La critique fondamentale doit porter sur les présupposés épistémologiques mêmes de la psychométrie.
L'impossibilité logique de mesurer l'intelligence
L'intelligence n'est pas un objet naturel comme la température ou la masse. C'est un construit social historiquement et culturellement situé. Prétendre la mesurer revient à commettre une erreur catégorielle fondamentale : appliquer les méthodes des sciences physiques à un phénomène social.
L'intelligence n'existe pas "en soi" Ce que nous appelons intelligence est :
- Un ensemble de comportements valorisés socialement
- Variable selon les époques et les cultures
- Indissociable du contexte de son expression
- Irréductible à une mesure unique.
Mesurer l'intelligence avec un test, c'est comme mesurer l'amour avec un thermomètre : l'instrument crée l'illusion de mesurer quelque chose qui n'existe pas sous la forme supposée.
J'ajoute que parler de l'intelligence, au singulier, c'est aussi absurde que de parler de l'amour au singulier, leurs expressions empiriques sont tellement variées et variables qu'il n'y a que le concept nommé pour maintenir l'illusion d'unicité.
La violence épistémique de la quantification
La réduction de la complexité cognitive humaine à un nombre constitue une forme de violence épistémique : elle détruit la richesse du phénomène pour le faire entrer dans une grille de lecture simpliste.
Cette violence opère par :
- Réduction : la diversité infinie des intelligences devient un score
- Hiérarchisation : les différences deviennent des supériorités/infériorités
- Essentialisation : les performances contextuelles deviennent des essences
- Naturalisation : les constructions sociales deviennent des faits biologiques.
Les alternatives absentes : refuser le piège des contre-modèles
Une erreur fréquente consiste à opposer au modèle du QI d'autres modèles (intelligences multiples, intelligence émotionnelle). Ces alternatives, aussi séduisantes soient-elles, reproduisent les mêmes erreurs fondamentales : elles tentent de capturer et catégoriser ce qui devrait rester ouvert et fluide. L'intelligence est une idée, pas une réalité "concrète", le pléonasme peut parfois aider à mieux cerner l'absurdité d'un propos. Il existe tant de définitions de l'intelligence, largement inconciliables entre elles qu'il est incroyable qu'on veuille maintenir l'hypothèse d'une intelligence mesurable.
Pourquoi Gardner et Goleman ne sont pas la solution
Les théories des intelligences multiples ou émotionnelles :
- Multiplient les catégories sans questionner la catégorisation
- Créent de nouvelles hiérarchies (être "fort" ou "faible" en intelligence musicale)
- Maintiennent l'obsession évaluative
- Génèrent de nouveaux marchés (tests d'intelligence émotionnelle).
Le problème n'est pas le modèle utilisé mais la volonté même de modéliser l'intelligence.
Pour une approche non-évaluative
Plutôt que chercher de "meilleurs tests", il faudrait :
- Abandonner toute prétention à mesurer l'intelligence
- Reconnaître la diversité cognitive sans la hiérarchiser
- Valoriser toutes les formes de pensée sans les comparer
- Accompagner chaque enfant sans le catégoriser.
X. Comment résister à la pression HPI : guide pratique pour les parents
Face aux propositions de bilan
Si un professionnel vous propose un bilan HPI, demandez systématiquement :
- Quelle est la marge d'erreur précise du test pour le score de mon enfant ?
- Pouvez-vous m'expliquer la fiabilité de chacun des 15 scores du WISC-V ?
- Quelle est l'utilité concrète du diagnostic pour mon enfant ?
- Quels sont les tarifs complets incluant les suivis éventuels ?
- Sur combien de personnes les normes pour ce niveau de QI sont-elles basées ?
J'ajoute qu'on est en droit d'attendre d'un professionnel qui vend de l'avenir une promesse de réussite du HPI meilleure que pour celles et ceux qui ne le sont pas... ha bah non puisque l'étude longitudinale sur les surdouées insiste avec aucun prix Nobel chez les surdoués étiquetés et deux prix Nobel chez les enfants refusés à la "dignité" de surdoués... CQFD ! (J'avais plutôt envie d'écrire "dans ta face" mais c'est moins académique, je sais je suis taquin)
Si votre enfant rencontre des difficultés scolaires ou comportementales :
- Privilégiez d'abord l'observation pédagogique fine par l'équipe enseignante
- Cherchez des causes concrètes : sommeil insuffisant, problèmes relationnels, méthodes d'apprentissage inadaptées
- Consultez l'équipe éducative avant tout professionnel libéral
- Méfiez-vous des explications "magiques" qui attribuent tout au HPI
- Rappelez-vous que la curiosité, la sensibilité et le perfectionnisme sont des traits normaux
Questions à poser avant d'engager 500-800€ dans un bilan :
- Mon enfant souffre-t-il réellement ou est-ce mon anxiété parentale ?
- Les difficultés persistent-elles malgré des adaptations pédagogiques simples ?
- Le diagnostic changera-t-il concrètement quelque chose à sa prise en charge ?
- Ne suis-je pas en train de chercher une étiquette valorisante ?
Conclusion : L'urgence d'en finir avec l'imposture HPI
Au terme de cette analyse approfondie, le constat est accablant. Le concept de HPI, depuis l'invention par Ajuriaguerra en 1946 de surdoués jusqu'à son exploitation commerciale contemporaine, constitue une construction scientifiquement invalide, éthiquement problématique et socialement destructrice.
Un château de cartes scientifique
Les fondements scientifiques du HPI s'effondrent à l'examen :
- L'héritage eugéniste de Terman, jamais vraiment questionné, contamine encore les pratiques
- Les problèmes d'étalonnage rendent toute mesure précise illusoire (marges d'erreur de 5 à 12%)
- Seulement 2 scores sur 15 du WISC-V atteignent la fiabilité minimale pour un usage clinique
- 70% des tests exhibent des biais culturels discriminatoires
- Les sophismes épistémologiques (réification, circularité) invalident la démarche même.
Comment continuer à fonder des décisions lourdes - orientation scolaire, diagnostic, thérapie - sur des bases aussi fragiles ? Je ne peux m'empêcher de rappeler ici que la définition même de l'"intelligence" n'est pas faite de manière univoque. Le concept sur lequel repose celui de HPI n'est pas clairement défini.
Un business cynique et prédateur
Le marché du HPI exploite systématiquement :
- L'anxiété parentale dans une société ultra-compétitive où les parents craignent le déclassement social de leurs enfants
- Le besoin de reconnaissance dans un monde déshumanisé où chacun cherche à se distinguer
- La culpabilisation des familles ("optimisez le potentiel de votre enfant ou il sera votre faute s'il échoue")
- L'absence totale de régulation permettant toutes les dérives commerciales et éthiques.
Une partie des psychologues en quête de clientèle, les coachs autoproclamés experts, les auteurs de best-sellers, tous participent (de leur plein gré ou pas) à cette exploitation organisée de la détresse familiale, transformant l'anxiété légitime (ou le désir de reconnaissance) des parents en source de profits.
Une idéologie néolibérale toxique
Le HPI n'est pas qu'une erreur scientifique ou une dérive commerciale. C'est un symptôme de l'idéologie néolibérale qui :
- Marchandise l'enfance en transformant les enfants en produits à optimiser
- Naturalise les inégalités en les attribuant à des différences innées
- Détruit le commun en fragmentant l'école en dispositifs ségrégués
- Installe la compétition dès le plus jeune âge.
Cette idéologie fait de la performance mesurable l'alpha et l'oméga de la valeur humaine, réduisant la richesse infinie de l'intelligence à un score.
Les dégâts humains considérables
Derrière les chiffres et les analyses, il y a des souffrances réelles :
- Familles endettées pour des diagnostics contestables
- Enfants étiquetés portant le poids d'une identité imposée
- Fratries divisées entre les "doués" et les "ordinaires"
- Parents culpabilisés de ne pas être "à la hauteur"
- Enseignants désemparés face aux demandes contradictoires...
Le coût humain de cette imposture est incalculable.
L'urgence d'agir
Face à ce constat, l'action est urgente :
Au niveau individuel :
- Refuser les tests psychométriques non validés scientifiquement pour ses enfants
- Questionner les professionnels sur les limites de leurs outils
- Résister à la pression sociale du diagnostic
- Valoriser toutes les formes d'intelligence sans hiérarchie
Au niveau collectif :
- Exiger une régulation du marché des tests
- Demander la transparence sur les marges d'erreur
- Militer pour une école véritablement inclusive
- Dénoncer les conflits d'intérêts
Au niveau politique :
- Interdire l'utilisation des tests de QI pour l'orientation scolaire
- Imposer le remboursement des bilans pour éviter la discrimination par l'argent
- Former les enseignants à la neurodiversité sans catégorisation
- Investir dans une école publique de qualité pour tous.
Pour une approche humaniste de la diversité cognitive
L'intelligence humaine est trop riche, trop complexe, trop contextuelle pour être capturée par un test. Chaque enfant possède un univers cognitif unique, évoluant selon les rencontres, les apprentissages, les contextes. Réduire cette richesse à un score, c'est commettre une erreur lourde de conséquence pour nos enfants.
Plutôt que de dépenser des millions en bilans psychométriques douteux, investissons dans :
- Une pédagogie respectueuse de tous les styles d'apprentissage
- Des classes à effectifs permettant l'attention à chacun (comment soutenir que plus de 30 élèves dans une classe c'est bien ?)
- La formation continue des enseignants
- Le soutien et accompagnement aux familles en difficulté.
Le véritable enjeu n'est pas d'identifier une minorité de "surdoués" mais de permettre à chaque enfant de développer ses potentialités, quelles qu'elles soient.
On peut me reprocher de n'avoir fait aucune place dans cet article à des arguments qui pourraient soutenir ce concept de HPI. Cependant le seul soutien à ce concept provient des tests de QI. Nous avons vu avec quelle rigueur statistique et scientifique ils sont conçus et déployés. Je n'ai donc aucune difficulté à assumer le fait que je n'ai donné aucune place à des arguments qui pourraient soutenir le concept de HPI : il n'y en a aucun de nature scientifique démontrée !
Le mot de la fin
Face aux millions d'euros annuels que génère ce marché en exploitant la détresse familiale, face aux dizaines de milliers d'enfants étiquetés sur la base de tests dont seulement 2 scores sur 15 atteignent la fiabilité requise pour les décisions individuelles, face aux marges d'erreur de 12% dissimulées aux familles, face à cette imposture scientifique qui naturalise les inégalités sociales, l'urgence est absolue.
Le concept de HPI est un miroir aux alouettes, une fable rassurante mais toxique qui nous détourne des vrais enjeux éducatifs et sociaux. Comme le montrait déjà l'échec de l'étude de Terman - aucun Prix Nobel parmi ses 1,528 "génies" alors que deux exclus de l'étude pour QI "insuffisant" l'ont obtenu - ce qui fait la réussite et l'épanouissement humains, ce ne sont pas des scores de tests mais la confiance, le soutien, les opportunités, la persévérance.
Il est temps de tourner cette page sombre de l'histoire de la psychologie et de construire une approche véritablement humaniste, scientifique et éthique de la diversité cognitive. Nos enfants méritent mieux que d'être réduits à des chiffres dans un business lucratif. Ils méritent d'être reconnus, accompagnés et valorisés dans toute leur singularité, sans étiquettes ni hiérarchies qui produisent essentiellement des déconvenues.
L'avenir de l'éducation ne passe pas par la multiplication des catégories et des tests basés sur des sophismes épistémologiques, mais par la création d'environnements bienveillants où chaque forme d'intelligence peut s'épanouir et contribuer au bien commun. C'est ce projet, véritablement émancipateur, qui devrait mobiliser nos énergies, nos ressources et notre créativité collective et pas la stigmatisation.
Bibliographie
Sources historiques et biographiques
- Ajuriaguerra, J. de (1946). Manuel de psychiatrie de l'enfant. Paris: Masson.
- Maitron (Ed.). "Ajuriaguerra (de) Julián". Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français.
- Medfilm - Université de Strasbourg. "Julian de Ajuriaguerra". Base de données Medfilm.
- Psynem. "Julian de Ajuriaguerra". Encyclopédie Psynem.
Études sur Lewis Terman et l'héritage eugéniste
- Leslie, M. (2000). "The Vexing Legacy of Lewis Terman". Stanford Magazine.
- Oden, M. H. (1968). "The fulfillment of promise: 40-year follow-up of the Terman gifted group". Genetic Psychology Monographs, 77, 3-93.
- Terman, L. M. (1925-1959). Genetic Studies of Genius (Vols. 1-5). Stanford University Press.
Critiques méthodologiques et épistémologiques
- Canivez, G. L., & Kush, J. C. (2013). "WAIS-IV and WISC-IV Structural Validity: Alternate Methods, Alternate Results". Journal of Psychoeducational Assessment, 31(2), 157-169.
- Institut des Politiques Publiques. (2017). "La taille des classes influence-t-elle la réussite scolaire ?". Note IPP n°28.
- Manly, J. J., et al. (2016). "Pitfalls of IQ Test Standardization in Multicultural Settings". Clinical Neuropsychologist, 30(8), 1265-1285.
- Ministère de l'Éducation Nationale. (2006). "L'effet d'une réduction de la taille des classes sur la réussite scolaire". Rapport d'évaluation.
- Mosteller, F. (1995). "The Tennessee Study of Class Size in the Early School Grades". The Future of Children, 5(2), 113-127.
- Shuttleworth-Edwards, A. B. (2016). "Generally Representative is Representative of None". Clinical Neuropsychologist, 30(7), 975-998.
- Uher, J. (2021). "Quantitative psychology under scrutiny: Measurement requires not result-dependent but traceable data generation". Personality and Individual Differences, 170, 110205.
- Watkins, M. W., & Canivez, G. L. (2019). "Long-term stability of Wechsler Intelligence Scale for Children–fifth edition scores in a clinical sample". Applied Neuropsychology: Child, 11(4), 629-634.
Biais culturels et discrimination
- American Psychological Association. (2020). "Cultural bias in psychological testing". APA Guidelines.
- Psicosmart. (2023). "Understanding Cultural Bias in Online Psychometric Tests". Blog Psicosmart.
Analyses du marché et critiques contemporaines
- Gauvrit, N., & Ramus, F. (2017). La légende noire des surdoués. Paris: La Découverte.
- HuffPost. (2023). "Des psychologues dénoncent le business des diagnostics HPI". HuffPost France.
- Mensa France. (2022). "Le business des surdoués est tout à fait juteux, dénonce Nicolas Gauvrit". Blog Mensa France.
- TF1 Info. (2023). "Arnaque aux tests HPI : nos conseils pour déjouer les pièges". TF1 Info.
Neuromythes et psychologie cognitive
- Brault Foisy, L.-M., et al. (2019). "Sommes-nous plutôt cerveau droit ou cerveau gauche?". Synapses - Fondation La main à la pâte.
- Cortex Mag. (2020). "Neuromythe #5 : cerveau droit, cerveau gauche". Magazine Cortex.
- Dynamic Brain. "Mythes à propos du cerveau". Resources DynamicBrain.
Analyses sociologiques et critiques du néolibéralisme
- Attac. "Les mécanismes psycho-sociaux de l'aliénation néolibérale". Blog Attac France.
- Encyclopédie de l'Agora. "Les enfants du néo-libéralisme". Dossier thématique.
- Revue Éducation et Sociétés. (2023). "Quand le capitalisme retourne les valeurs de l'éducation". OpenEdition Journals.
Documents institutionnels et rapports
- Éducation Nationale. (2019). "La scolarisation des élèves intellectuellement précoces". Rapport ministériel.
- Organisation Mondiale de la Santé. (2022). "Classification internationale des maladies - 11e révision (CIM-11)". WHO Publications.